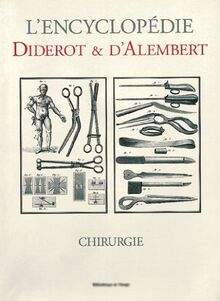Causerie avec les Compagnons du Devoir (Maison de Pantin) - le jeudi 15avril 2021
Introduction
Je remercie Pierre Noé de m’avoir invité à m’adresser à vous
sur un sujet qui me semble particulièrement important. J’ai publié récemment un
article intitulé « Panne de transmission » et comme vous le savez on peut
rouler avec une panne de climatisation, mais pas avec une panne de
transmission. Or il me semble bien qu’un des défis les plus importants que nous
ayons à affronter aujourd’hui soit le défi de la transmission : comment
les générations peuvent-elles continuer à se transmettre tout ce qui doit être
transmis ?
Pourquoi est-ce si important ?
Il y a de nombreux usages du mot transmission. Le moteur
transmet son énergie aux roues pour faire avancer le véhicule. Le courrier
transmet des informations et l’officier transmet les ordres de ses supérieurs
aux hommes du rang. Laissant tomber ici les usages du mot en mécanique et en
théorie des communications, je vais me concentrer sur une utilisation
particulière du mot « transmission » quand il s’agit de faire passer quelque
chose d’une génération à l’autre.
On peut définir l’homme par beaucoup de choses :
l’homme est l’animal qui parle (les hommes échangent des paroles porteuses de
sens et pas seulement des signaux à efficacité immédiate) ; l’homme est
l’animal qui fabrique des outils ; l’homme est l’animal qui a conscience de la
mort et pratique, sous des formes diverses, le culte des morts ; etc. Ma
proposition ici est celle-ci : la transmission entre les générations est la
marque la plus évidente de l’entrée de l’homme dans un ordre qui lui est
spécifique et qui le sépare définitivement des autres animaux, même s’il reste
évidemment un animal ! En effet, d’une génération à l’autre nous transmettons
l’essentiel de ce qui fait notre vie, de ce qui fait que nous menons une vie
proprement humaine.
Nous transmettons notre humanité
Avant toute chose, nous transmettons notre humanité, de la
même manière que les autres espèces vivantes transmettent leurs
caractéristiques naturelles ! Quand on fait des enfants, on transmet ses gènes !
Mais pour les humains, il y a quelques grandes caractéristiques qui séparent
l’homme de ses voisins de genre, les grands primates, comme les gorilles, les
chimpanzés, les bonobos ou, un peu plus loin, les orangs-outangs. Ces
caractéristiques sont connues : la station verticale et la marche ou la
course sur deux jambes, une bonne vue bilatérale et un gros cerveau comportant
de très nombreuses circonvolutions avec le développement d’un gros néocortex
dédié aux fonctions intelligentes, la parole, les aptitudes techniques, la
réflexion. Tout cela a l’air banal, mais transmettre la vie est, pour les
humains, quelque chose d’assez compliqué, car s’y implique toute une dimension
sociale et culturelle dont nous allons parler. Un enfant n’apprendra à marcher
que si on l’aide et s’il trouve des modèles à imiter. Il n’apprendra à parler
qu’en entendant parler, bref, il ne devient humain qu’avec les autres humains.
Nous transmettons des techniques
Si nous nous tournons vers le passé de l’humanité, par quoi
reconnaissons-nous la présence de l’homme quand nous étudions les documents
archéologiques ? Par des outils, faits de pierres et d’os. Nous avons des
fossiles humains, des fossiles d’hommes archaïques qui diffèrent de nous par
bien des aspects. Leur boîte crânienne est bien plus petite, trois fois plus
petite que la nôtre pour homo habilis qui a vécu entre 3,5 et 2,3 millions
d’années avant nous. Après lui, nous avons homo erectus, et bien
d’autres. Mais grâce aux progrès des fouilles et à la génétique, et en
exploitant l’analyse du génome, nous en avons appris beaucoup plus sur eux.
Nous avons appris qu’ils possédaient quelques-unes des conditions biologiques
de la parole : la présence dans le cerveau de l’aire de Broca, la partie
du cerveau dédiée aux fonctions langagières, le gène Foxp2 et quelques
autres choses encore. Nous avons appris également que nos très lointains
ancêtres n’avaient pas de fourrure naturelle — on a parfois désigné l’homme
comme « le singe nu ». Et surtout nous savons qu’il fabriquait des outils, des
grattoirs, des sortes de couteaux, etc. C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’on parle d’homo habilis, l’homme habile. D’autres espèces du genre
homo sont venues ensuite, qui ont appris à utiliser le feu, à le maîtriser puis
à l’allumer, mais toutes ces espèces d’hommes se sont caractérisées par des
innovations techniques, maintenues et perfectionnées dans le temps, car
transmises aux générations suivantes.
On peut certes dire que les animaux ont des techniques :
les abeilles construisent les alvéoles de la ruche, les araignées tissent des
toiles, les hirondelles bâtissent leurs nids ; mais toutes ces techniques sont
purement instinctives, ne demandent aucun plan et surtout n’évoluent pas :
les nids d’hirondelles d’aujourd’hui sont rigoureusement identiques à ce qu’ils
étaient voilà mille ans ou dix mille ans ! Certains grands singes, nos cousins
les plus proches dans la lignée évolutive, sont capables de transformer une
branche d’arbre en outil, si l’occasion se présente, mais cette branche est
oubliée dès que son usage n’est plus nécessaire. Et aucun chimpanzé n’apprendra
à ses petits la taille des branches pour en faire des outils à attraper les
fruits.
Ce qui caractérise les techniques humaines tient en deux
choses :
-
Les hommes fabriquent des outils à fabriquer des
outils. Les hirondelles ou les abeilles n’ont pas d’autre outil que leur corps.
L’homme, lui, fabrique des outils pour tailler la pierre, car il est évidemment
impossible de tailler la pierre à mains nues !
-
Les hommes inventent des outils et transmettent
à leurs enfants les techniques qu’ils ont inventées. Et les générations suivantes
peuvent à leur tour améliorer ces inventions et en inventer d’autres.
Arrivé à un certain stade, ce processus connaît une
véritable explosion d’innovations. Le néolithique voit un perfectionnement
considérable des armes de chasse (le propulseur par exemple), la sophistication
des habitats (cabanes, maisons de pierres), puis l’invention de l’élevage et de
l’agriculture, etc. Cette explosion a environ 12 000 ans. Mais elle
procède de tout ce qui avait été inventé et de tous les savoirs accumulés
auparavant.
Tout cela n’est possible que parce que ces savoirs, ces
inventions, ces techniques sont transmis. Et pour la transmission, l’homme a un
avantage considérable : la parole qui permet de parler de ce qui n’est pas
là, de ce qui n’est plus, de ce qui est ailleurs ou de ce qui n’existe pas
encore. C’est encore la parole qui permet de donner des instructions complexes
avec une dépense d’énergie minimale. Que nous puissions nommer non seulement
les matières à travailler, mais aussi tous les outils indispensables, voilà
déjà un apprentissage fondamental : « prends le poinçon, coupe avec le
ciseau, pose un œillet, etc. ». L’apprentissage implique un vocabulaire, un
lexique, et celui des métiers est particulièrement riche ! Nous sommes à peu
près certains que nos frères néandertaliens, une espèce d’humains aujourd’hui
disparue, devaient eux aussi avoir un vocabulaire précis pour décrire les
objets dont ils avaient besoin et les outils à utiliser. Ils devaient savoir
choisir le bon bloc de pierre, pour ensuite le débiter de manière à obtenir des
éclats qui servaient à confectionner des bifaces. On sait aujourd’hui que notre
Néandertal savait débiter environ 2 mètres de tranchant par kilo de pierre
— contre 0,4 pour leurs ancêtres, l’homme de Heidelberg. On sait aussi que les
hommes de Néandertal maîtrisaient certaines techniques de fabrication des
outils à la base d’os — on a trouvé les outils qui devaient servir à assouplir
le cuir. Mais toutes ces techniques demandaient un apprentissage qui ne pouvait
pas se faire seulement par imitation.
Nous transmettons des paroles
Pendant très longtemps, la transmission par la parole se
heurtait au fait que « les paroles s’envolent ». Celui qui sait quelque chose
emporte son savoir dans la tombe ! Sauf s’il l’a communiqué par la parole et si
ceux qui l’ont entendu l’ont mémorisé et répété à leur tour. On faisait encore
quelque chose de ce genre à la campagne avant l’arrivée de la télévision. Les
soirées d’hiver étaient longues et on se réunissait en famille, avec des
voisins pour des veillées où, tout en s’activant à des choses utiles (éplucher
des marrons, coudre, etc.), on se racontait les histoires du village, les
histoires de famille et ainsi toute une mémoire se transmettait par la voie
orale.
Mais, la mémoire est faillible et ce qui se transmet par la
parole peut assez facilement se perdre ou se déformer. Environ 5 000 ans
avant notre époque, les humains ont inventé un outil de transmission
remarquable, l’écrit. L’écrit est sans doute né, d’abord, des besoins
d’administration des grandes cités, qui commencent à surgir au Proche-Orient. La
parole est plus pratique et plus économique que les gestes, les dessins, les
mimiques, et plus précise aussi puisqu’elle exige le développement de concepts,
mais l’écrit est le moyen le plus économique de transmettre la parole. Du même
coup, le pouvoir de la parole peut être décuplé. Le livre devient
progressivement le symbole de l’autorité — avec ce que l’on appelle les « religions
du livre ». C’est par le livre encore que la philosophie s’est développée et a
franchi les siècles, ce qui nous permet de lire Platon (IVe siècle av.
J.-C.) presque comme s’il était un de nos contemporains. Et ici la grande
révolution, c’est l’imprimerie qui va rendre le livre accessible à tous. Née
dans le monde protestant, l’imprimerie va rendre possible l’alphabétisation
généralisée et permet à tous les chrétiens d’avoir directement accès au texte
de l’Ancien et du Nouveau Testament sans être obligés de passer par l’intermédiaire
du prêtre. La transmission est bien passée à la vitesse supérieure.
Arrêtons-nous juste un instant sur cette question. La grande
avancée d’internet est de rendre encore plus facilement accessible l’écrit. En
ce sens, cette nouvelle technique contribue à la transmission. Mais, en ce
qu’elle favorise la circulation des images et des vidéos, la communication par
internet vise à éliminer le texte. Ainsi, si la vidéo peut être un auxiliaire
de la diffusion de la pensée, elle ne saurait remplacer l’écrit ! L’effet
pervers est qu’elle nous rend paresseux et occupe le temps que nous pourrions
consacrer à la lecture ou à la conversation directe, « en présence », et donc
fait reculer la sociabilité autant que la transmission véritable.
Nous transmettons un imaginaire
Dans un groupe d’humains, quelle que soit sa taille, il y a
quelque chose qui unit tous les membres du groupe, un lot d’idées et d’images
qui forment une communauté. Les récits fabuleux, mythiques ou religieux, les
contes et les chants, tout cela constitue un imaginaire commun. Tous les jeunes
Grecs apprenaient la vie dans les deux grandes épopées attribuées à Homère,
l’Iliade et l’Odyssée. Cet imaginaire peut s’enrichir ou s’appauvrir, mais
c’est à chaque génération de le transmettre à ceux qui viennent après. L’idée
même de la transmission, nous la voyons dans cette sculpture du grand artiste
italien Gian Lorenzo Bernini (Le Bernin en français, 1598-1680) inspirée d’un
passage de l’Énéide de Virgile. L’Énéide raconte ce qui se passe après
la chute de Troie et la défaite des Troyens vaincus après dix ans de siège et
grâce à la ruse d’Ulysse (le fameux cheval de Troie). Elle est comme une suite
de l’Iliade et l’Odyssée qui narre les épreuves qu’a subies le prince troyen Énée,
fils d’Anchise et de la déesse Vénus. Il finira par s’installer en Italie et
passe pour l’ancêtre du peuple romain. La sculpture de Bernini représente Énée
fuyant Troie en feu. Sur son dos, il porte son père Anchise et tient par la
main son fils Ascagne. C’est là une sorte de résumé de la condition de chaque
homme : porter son père sur son dos, c’est le destin de l’homme qui ne
doit pas seulement assumer la charge de la vieillesse de ses parents, mais
aussi leur héritage, pour le meilleur et pour le pire. Le poids des générations
mortes pèse sur les épaules des vivants, disait Marx. Mais il faut encore
surveiller ses enfants et les tenir par la main pour qu’ils ne s’égarent pas,
pour qu’ils prennent le bon chemin. Ainsi, loin d’être un atome isolé, comme
dans les fictions du contrat social, l’homme est d’abord un maillon entre les
générations. C’est pour cette raison qu’il est un animal historique autant que
social. Double rapport donc, vers l’avant et vers l’après, vers le passé et
vers l’avenir.
L’origine de la difficulté
La transmission est non seulement ce qui nous caractérise en
tant qu’humains, mais elle est aussi le problème majeur auquel nous sommes
confrontés. Les animaux se contentent de vivre (boire, manger, dormir…) et de
se reproduire. Les humains ne peuvent se laisser aller au flux de la vie. Ils
doivent « instituer la vie » et pour cela il y a trois dimensions :
1)
Au présent : nous ne vivons que dans et par
des institutions, régies par des lois. Elles sont bonnes ou mauvaises, mais peu
importe, il nous faut des institutions. Là où les animaux ont l’instinct pour
les guider, nous avons des lois, des écoles, un système judiciaire, des
représentants politiques, et aussi des règles de droit, propriété, rapports
sociaux, etc. Toutes ces institutions n’existent que parce que nous donnons foi
à des paroles. « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles »
disait un éminent juriste du XVIIe siècle !
2)
Vers le passé : nous ne nous sommes pas
faits tout seuls ! Seul le mythe américain peut faire croire que chacun est un
« self made man » ! Personne ne se fait seul : nous avons été engendrés
par nos parents qui, eux-mêmes, ont été engendrés par leurs parents. Nous nous
inscrivons ainsi dans une généalogie. Le philosophe Auguste Comte disait que la
société n’est pas composée que des vivants, mais qu’elle englobe aussi les
morts. Et, à ces morts, nous devons beaucoup de choses, nous sommes endettés
vis-à-vis d’eux. Ils nous ont laissé le pays et le monde dans lequel nous
vivons. Nous devons aux générations passées les routes, les voies ferrées, les
bâtiments, les écoles, les professeurs qui nous ont enseignés, etc. Le discours
commun de nos jours et qui a sans doute pas mal d’arrière-pensées, dit « Les “boomers”,
quelle dette allez-vous laisser aux générations futures ! » Mais non, ce sont
les générations futures qui sont endettées vis-à-vis de la génération précédente
qui a construit le réseau internet, les autoroutes, les TGV, les progrès
considérables de la médecine, et tant de choses encore. Mais plus encore, nous
devons aux générations qui sont venues avant nous notre langue, notre culture,
et finalement l’ensemble des rapports sociaux.
3)
Vers l’avenir : nous avons le devoir de
transmettre, en essayant de l’améliorer, ce que nous avons reçu. Nous devons
conserver le monde et non le saccager. Et donc nous devons également permettre
aux « nouveaux » d’entrer pleinement dans ce monde et de pouvoir exercer
pleinement leur liberté au moment où ils en seront capables. Tout le problème
de l’éducation est là. J’y reviens.
Ces trois dimensions de notre vie sont étroitement
solidaires. On ne peut comprendre le présent qu’en n’oubliant jamais le passé
et en s’efforçant de connaitre l’histoire et d’en garder vivantes les leçons.
On ne peut préparer l’avenir que dans le présent, mais ce que nous devons faire
dans le présent doit toujours prendre en compte l’avenir.
La question de l’éducation comme question centrale
La question de l’éducation est bien la question la plus
centrale de la transmission, même si on ne peut se limiter à cela. Éduquer,
cela a plusieurs sens : éduquer, c’est la même racine « duc » que celle
que l’on trouve dans conduire, conducteur. Un éducateur, c’est donc quelqu’un
qui conduit. On parle aussi de « pédagogue », mot qui vient du grec et désigne
celui qui conduit les enfants. Pourquoi faut-il éduquer les plus jeunes ? Tout
simplement parce que rien n’est instinctif chez les humains et qu’ils doivent
tout apprendre : marcher, parler, vivre avec les autres. Et cette
éducation est nécessairement celle que donnent les plus vieux.
Au cours des dernières décennies, on a raconté beaucoup de
calembredaines au sujet de l’éducation. On a dit qu’il fallait laisser les
enfants faire eux-mêmes leur expérience et que l’autorité des adultes était
tout à la fois néfaste et illégitime. On a dit que l’élève devait être au
centre du système scolaire et qu’il devait construire lui-même son propre
savoir, les maîtres, désormais dépourvus de toute autorité, devaient se
contenter d’être des accompagnateurs, les « techniciens de ressources » a-t-on
même dit, pendant que les élèves devenant des « apprenants », étaient promus au
rang des maîtres. Je n’ai pas le temps de faire le tour de toutes les
extravagances auxquelles la recherche dans les prétendues « sciences de
l’éducation » s’est laissé entraîner. Je ne peux pas non plus faire le tour de
toutes les réformes nocives où au nom de la garantie de la « réussite pour tous »,
on a abandonné chaque jour un peu plus les exigences du savoir.
Ceux qui apprennent un métier, comme vous, savent
parfaitement que l’à-peu-près, le je-m’en-foutisme et l’absence d’efforts ne
mènent à rien. Celui qui apprend à travailler le bois sait que la matière ne
pardonne pas : si la mortaise n’a pas été bien faite, précisément,
régulièrement, selon les dimensions exactes, le meuble ne pourra jamais être
assemblé ou s’écroulera à la première occasion. Nous avons, en France, un gros
problème avec les soudures. Comme vous le savez certainement, la nouvelle
centrale nucléaire EPR qui est en construction à Flamanville a pris des retards
considérables. Initialement, la centrale devait être mise en service en 2012…
de retard en retard, nous voilà maintenant à 2024 ! Or l’un des problèmes
majeurs rencontrés a été celui de la qualité des cuves, c’est-à-dire de la
qualité des soudures. Pourquoi ce problème de qualité ? Parce que les
savoir-faire se sont largement perdus et que l’on a du mal à trouver des
soudeurs ultra qualifiés pour ce genre de travaux. À l’école, on tolère
maintenant des fautes d’orthographe énormes, on admet qu’un élève ne sache plus
faire « 4 + 3 » sans utiliser sa calculette. Tout cela ne semble pas très grave !
Mais dans la vie, les fautes de soudure et les erreurs de calcul de résistance
des matériaux ne pardonnent pas !
La première chose que doit apprendre l’école, avant tout
savoir particulier, c’est la rigueur et la discipline, la concentration sur son
travail, la capacité à prendre en compte consignes et conseils, et à organiser
son temps pour réaliser la tâche demandée dans les délais impartis. Pour mener
à bien cette tâche, il y a une structure des rapports entre maître et élève ;
le maître n’est pas le copain des élèves. Le maître : le mot vient du
latin et désigne ce qui est plus élevé — c’est la même racine que « magistrat ».
L’élève, c’est celui qui doit s’élever et donc aller plus haut, vers cette
hauteur où se tient le maître, celui qui dispose de l’autorité. L’autorité
vient d’un verbe latin (augeo) qui veut dire faire croître,
augmenter.
L’école évidemment n’est pas seule dans cette tâche. Les
premiers éducateurs sont les parents ! Et la puissance publique à travers ses
lois, poursuit cette éducation tout au long de la vie. Mais l’école dans nos
sociétés a bien un rôle central.
Il y a dans l’éducation deux lignes directrices :
1)
Transmettre des savoirs et enseigner des
techniques. L’école nous apprend la date de la bataille de Marignan et les vers
les plus fameux du Cid de Corneille. De ce point de vue, elle transmet
bien des savoirs qu’il faut admettre et apprendre. Mais elle enseigne aussi des
techniques : apprendre à écrire, sans faute de grammaire ni d’orthographe,
c’est apprendre à maîtriser une technique. Comme savoir faire des opérations
arithmétiques, tracer des figures avec la règle et le compas ou résoudre des
systèmes d’équations en mathématiques, ce sont des techniques.
2)
Inculquer des valeurs et des bonnes habitudes.
Avant d’être en âge de comprendre la nature de ces valeurs, de les juger et
éventuellement de les critiquer, il faut les avoir faites siennes et il faut
admettre les règles de base de la vie commune, ce que l’on appelle politesse. Pour
apprendre, il est nécessaire de savoir accepter la discipline, respecter les
consignes, se tenir à sa place et donc se plier aux règles d’une classe, par
exemple.
La plus grosse difficulté de l’éducation aujourd’hui tient
en ceci : les spécialistes en pédagogie, les médias, beaucoup d’hommes
politiques, par démagogie ou par intérêt, flattent la jeunesse : les
jeunes en savent plus que les anciens, disent-ils, les « digital natives » s’y
connaissent en informatique alors que les anciens sont des handicapés… Bref,
les anciens n’ont rien à transmettre aux plus jeunes. Platon le disait
déjà : la flatterie est un poison et la flatterie de la jeunesse est « le
vigoureux commencement de la tyrannie ». Et c’est bien ce qui nous
menace : la tyrannie du plaisir immédiat, la tyrannie de la consommation à
tout prix, la tyrannie de l’argent.
Le rapport à la tradition
La transmission suppose un rapport à la tradition que nous
sommes peut-être en train de perdre. Aujourd’hui nous sommes persuadés que ce
qui est ancien ne vaut plus rien (sauf sur le marché des antiquités !) et que
ce que nous faisons aujourd’hui est mieux que ce que l’on faisait hier et de
demain sera mieux qu’aujourd’hui. Donc, nous n’aurions rien à apprendre des
traditions et celles-ci n’auraient en elles-mêmes rien de respectable.
Évidemment, certaines traditions ont, à juste titre, été
abandonnées. Nous ne pratiquons plus la torture dans les procédures judiciaires
et la peine de mort a été abandonnée. La technique moderne vaut souvent mieux
que les cierges allumés à l’église pour faire face aux épidémies ou aux
calamités naturelles ! Mais, croyants ou non, nous suivons encore souvent les
fêtes religieuses traditionnelles : Noël, Pâques, la Pentecôte, l’Assomption
ou la Toussaint. Au-delà de leur origine religieuse, ces fêtes font partie de
notre culture nationale au même titre que les fêtes nationales (1er mai,
14 juillet, 11 novembre) ou calendaires comme le jour de l’An. Et ces
traditions festives font partie intégrante de la vie sociale : elles sont
des occasions de générosité, des occasions de resserrer les liens amicaux ou
familiaux, des occasions aussi de se souvenir des morts (le 2 novembre est
la journée des morts).
Il y a des coutumes qui demeurent et qui ne disparaissent
pas dans une vie sociale réduite à des procédures rationnelles. Ainsi, le
mariage n’est-il plus, juridiquement, qu’un contrat de droit civil (et non un
sacrement ou une alliance entre familles), mais on continue de le célébrer par
une fête. Si quelqu’un passe vous voir, vous lui offrez à boire, dernière trace
de cette antique loi de l’hospitalité. Même les affaires se font souvent autour
d’un repas, parce que tous les moments importants se font autour d’un repas. On
parle beaucoup de « vivre ensemble », nouvelle tarte à la crème des politiciens
et des gens de médias. Mais vivre ensemble c’est assez simple : c’est
manger et se marier ensemble. Et c’est respecter cette antique loi du don qui a
toujours fait les sociétés : donner, recevoir, rendre.
Tout cela est mis en cause aujourd’hui et semble en voie de
désagrégation. Manger ensemble devient compliqué puisque celui qui se rend à
une invitation vient avec toutes ses particularités — pas de gluten, pas de
viande, pas de porc, etc. — et finalement se présente chez vous comme s’il
faisait ses courses au supermarché. Les cadeaux sont remplacés par des
bons-cadeaux ou des chèques cadeaux, qui ne sont rien d’autre que de la monnaie
et n’ont plus grand-chose à voir avec le don. Mais l’avantage est qu’on est certain
que le cadeau sera accepté ! Ce faisant, on remplace progressivement le don par
l’échange marchand et on défait les liens communautaires.
La tradition s’ancre dans l’histoire
Ce qui fait une nation, c’est qu’elle est une communauté de
vie et de destin. Elle suppose que son histoire soit transmise. Parfois, il
m’arrive de penser que la discipline scolaire la plus importante est
l’histoire.
L’histoire est un « roman national » : voilà la
première idée que l’on devrait se mettre en tête. Nous n’apprenons pas
l’histoire en général et à l’école on n’a pas à faire de l’histoire comme le
ferait un historien de métier. Nous n’avons pas à transmettre, aussi
intéressante et aussi digne soit-elle, l’histoire de l’Australie ou de la
Mongolie, mais d’abord l’histoire de France et un petit morceau de celle des
autres pays liés à notre histoire. Et de cette histoire nous retenons ce qui a
forgé notre caractère national et ce qui nous permet de garder une certaine
estime de nous-mêmes. Certes, il y a des parts d’ombres dans notre histoire et
bien des épisodes dont nous ne sommes pas fiers du tout, mais le plus important
est de savoir comment nous les avons surmontés. Oui, notre pays s’est effondré
en 1940 avec la débâcle. Mais nous en sommes sortis grâce à la Résistance et
aux grandes réformes de 1945.
Les exercices de
repentance auxquels on nous convie aujourd’hui ont quelque chose d’un peu
inconvenant. Oui, les Européens ont pratiqué l’esclavage, mais pas plus que
bien d’autres civilisations (par exemple en durée et en nombre plutôt moins que
les Arabes ou les Ottomans) ; mais ce sont seulement les Européens qui se sont
avisés de critiquer le principe même de l’esclavage et de l’abolir. On pourrait
aussi faire le bilan de la colonisation et on verrait que la réalité est plus
compliquée que les simplifications outrancières auxquelles on nous somme de
croire aujourd’hui.
Bref, notre histoire est à prendre en bloc ! Cette histoire
nous a fait et a modelé nos paysages. La France est laïque juridiquement,
philosophiquement, politiquement, mais il faudrait être aveugle et sourd pour
ne pas comprendre que nous avons été modelés par le christianisme catholique et
par la romanité.
Pour conclure
Une des difficultés que nous rencontrons dans la
transmission, une difficulté que je n’ai pas encore abordée tient au caractère
multiculturel ou multiethnique que prennent aujourd’hui nos sociétés en Europe.
S’il faut transmettre la tradition, que faire quand plusieurs traditions se
heurtent ? Là encore, nous avons chacun nos traditions ! Les Anglo-saxons sont
volontiers multiculturalistes et admettent plus facilement que nous la
cohabitation de plusieurs communautés aux règles et coutumes très différentes.
C’est un héritage de leur propre histoire qui est celle d’une
demi-décolonisation et du maintien de beaucoup d’anciennes colonies anglaises
sous la couronne britannique (le Commonwealth). C’est aussi sans doute une
question de mentalité : les Anglais ne sont pas égalitaristes et ils n’ont
jamais vraiment pensé qu’un Anglais et un Indien pouvaient se valoir ! Nous, au
contraire, nous sommes égalitaristes et assimilationnistes. Nous n’aimons les
étrangers que s’ils veulent devenir de bons Français comme les autres ! Il y a
chez nous, comme partout, mais plutôt un peu moins qu’en bien d’autres pays,
une peur de l’étranger et un racisme presque naturel vis-à-vis de celui que
l’on ne connaît pas. Mais rien de plus. Pour le reste, ceux qui veulent venir
chez nous le peuvent en adoptant notre histoire et nos mœurs. Comme le dit un
vieux proverbe : si tu vas à Rome, fais comme les Romains !
Rien de ce que je viens de dire n’implique que nous tombions
dans l’immobilisme. La transmission est comme une course de relai : chaque
génération passe le bâton à la suivante, mais la course continue. Nous
apprenons du passé aussi pour ne pas recommencer. Je crois que c’est
l’historien et résistant Marc Bloch qui disait : celui qui ignore son
histoire est condamné à la revivre. Il y a des moments où l’on donne un grand
coup de balai : par exemple, la Révolution française de 1789-1793. Mais
après ces grands coups de balai, on ne se retrouve pas sur une table rase, on
fait disparaître ce qui est mort, mais on garde beaucoup de choses de ce passé
que l’on vient d’étriller.
Aujourd’hui, alors que la mondialisation a ébranlé toutes
les institutions les plus vénérables, mais aussi saccagé des pans entiers de
notre industrie, nous ne pouvons pas envisager l’avenir sans conserver
précieusement ce qui nous a été transmis. Et si nous ne parvenons pas à
transmettre ce qui nous fait être comme nation, alors l’avenir sera
certainement très difficile. Voilà le défi qui se pose à nous, les vieux, et à
vous, les jeunes.
Le 14 avril 2021