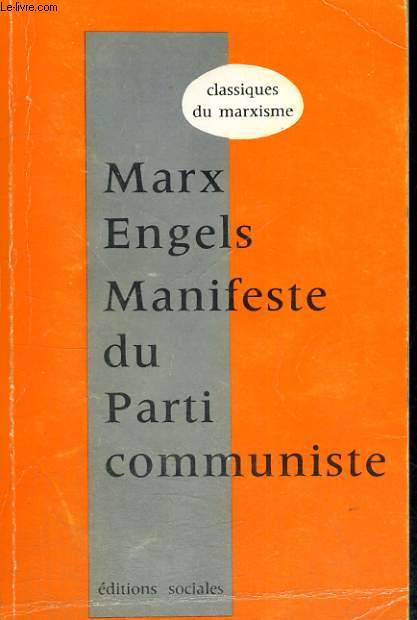Il est des commencements célèbres. La Recherche de
Proust : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Ou Aurélien
d’Aragon : « La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva
franchement laide ». Le Capital de Marx propose lui aussi un
incipit célèbre : « La richesse des sociétés dans lesquelles règne le
mode de production capitaliste apparaît comme une gigantesque collection de
marchandises ». « La richesse apparaît » dit Marx. Apparaît mais
n’est pas cela ! Car la richesse n’est pas faite de marchandises ou pas
seulement de marchandises. L’air, l’eau des sources, de la rivière ou de la
mer, les paysages, les beautés que les siècles passés nous ont laissées à
admirer, l’amitié et l’amour, voilà de vraies richesses ! Et ces richesses
ne sont pas des marchandises. Même les biens que l’on pouvait accumuler dans
les sociétés archaïques, toutes ces réserves de nourriture que l’on pouvait consommer
d’un coup dans un potlatch, ce n’étaient pas des marchandises. La
domination de la marchandise, voilà ce qui fait le propre de nos sociétés,
depuis maintenant quelques siècles, mais qui prend aujourd’hui des formes
particulièrement aiguës, ne laissant plus guère de place à ce qui pourrait
n’être pas marchandise.
Pour qu’une chose soit une marchandise, il faut d’abord
qu’elle soit produite, d’une manière ou d’une autre, par le travail humain,
mais plus encore il faut qu’elle soit consommée à travers l’achat sur un
marché. C’est pourquoi, à partir de la deuxième partie du XXe siècle, certains
auteurs (je pense d’abord à Marcuse et aux théoriciens de l’école de Francfort)
ont commencé à parler de « société de consommation ». C’était
l’époque de l’accès généralisé à l’électro-ménager, aux choses en plastiques, aux
autos pour le grand public. L’époque où Boris Vian chantait les « arts
ménagers », l’époque où Georges Pérec écrivait « Les choses »,
l’époque des « trente Glorieuses » et de « Moulinex libère la
femme ». On pourrait critiquer ce concept de « société de
consommation », alors même que la plus grande partie de l’humanité reste
privée du nécessaire, de l’eau, de nourriture saine et en quantité suffisante,
de soins, etc. Et pourtant, ce concept peut être conservé et précisé pour trois
raisons :
1)
La pauvreté persistante et parfois grandissante
et les menaces qui pèsent sur l’avenir même de l’humanité découlent de la
frénésie de consommation qui est le ressort de toute la vie sociale et économique.
Ce que consomme la société de consommation, c’est le monde des humains.
2)
L’accumulation illimitée du capital est la
finalité délirante de notre « système économique », et pour cette
raison la consommation n’est plus le moyen de satisfaire les besoins humains, mais
le moyen de stimuler la production pour augmenter la consommation pour stimuler
la production. Nous sommes comme les hamsters qui tournent dans leur roue pour
manger.
3)
La consommation revêt un caractère religieux,
découlant de ce que Marx appelait « fétichisme de la marchandise » et
en cela elle modèle les consciences et les comportements.
(1)
Si on veut distinguer le mode de production capitaliste de
tous les modes de production antérieurs, on peut dire, schématiquement, que
tous les modes de production antérieurs reposaient sur la nécessité de
satisfaire les besoins : produire permettait de faire vivre assez mal les
plus pauvres, les producteurs, et assez bien, les classes dominantes. La
consommation ostentatoire était un des éléments nécessaires pour aider les
dominants à montrer leur puissance et assurer ainsi leur domination sur les
dominés. Avec le mode de production capitaliste, les choses changent. D’abord
la consommation des dominants n’est pas du tout le but du système. L’éthique
protestante (lire Benjamin Franklin) est une éthique dans laquelle le travail
n’a pas d’autre finalité que l’accumulation. Se priver du luxe, refuser la
consommation ostentatoire sont des comportements vertueux. Le but du mode de
production, c’est la production de la survaleur pour permettre l’accumulation
du capital. « Valorisation de la valeur », dit Marx. Et rien
d’autre ! Ne parlons pas des besoins des ouvriers, qui, si minces qu’ils
soient, sont toujours trop importants pour le capitaliste en lutte pour faire
baisser ce damné « coût du travail ».
Problème : si ni le capitaliste ni l’ouvrier ne
consomment, qui consommera les marchandises produites par le mode de production
capitaliste ? Une partie importante de ces marchandises est consommées
dans la production capitaliste elle-même : pour produire, il faut des
machines, des matières premières, des produits semi-finis, etc. C’est tout ce
que Marx, dans ses analyses du livre II du Capital fait entrer dans le
secteur I, le secteur II étant celui des biens destinés à la consommation
finale. Le problème, c’est que le secteur II trouve les moyens d’acheter les marchandises
du secteur I en vendant ses marchandises, ses automobiles, ses plats préparés
ou ses téléphones portables. Rosa Luxemburg, confrontée à cette question
supposait que les capitalistes avaient donc toujours besoin de trouver des
acheteurs en dehors de la sphère propre du mode de production capitaliste,
comme les Anglais obligeaient les Indiens à acheter leurs tissus ou les Chinois
à consommer de l’opium. Mais au fur et à mesure de l’expansion du mode de
production capitaliste, il fallait trouver de nouveaux marchés et, la Terre
étant limitée, un jour arriverait où ce ne serait plus possible et alors
éclaterait la crise finale du capitalisme.
En fait le capitalisme a « trouvé » une autre
solution : crises et guerres permettent de détruire massivement des
marchandises et du capital et de relancer la machine économique. La dette
publique, les investissements dans l’économie d’armement, toutes les formes du
capital fictif permettent d’administrer au mode de production capitaliste des
drogues qui temporairement éloignent le mal : encore un instant, monsieur
le bourreau !
Cette analyse classique du mode de production capitaliste au
XXe siècle n’est cependant pas suffisante. La course à la productivité du
travail et à l’innovation technologique combinée à la pression de la
« lutte des classes », c'est-à-dire à la lutte du travail contre le
capital pour la défense du salaire ont conduit au développement d’une
consommation de masse qui a ouvert de nouveaux champs d’accumulation du
capital. L’électricité s’est répandue avant l’eau courante, parce que
l’électricité permettait de vendre toutes sortes de produits nouveaux (je
connais bien des villages où on avait réfrigérateur, lave-linge et télévision
avant d’avoir l’eau courante). Si l’économie d’armement a joué un rôle
fondamental dans la croissance des « trente glorieuses », la
« société de consommation », née d’abord aux États-Unis a été le
deuxième pilier de cette période de prospérité relative qu’aujourd’hui on
regarde encore avec une certaine nostalgie.
La consommation de masse a permis de recycler immédiatement
les concessions que la classe dominante avait dû faire aux dominés. Selon le
principe de M. Ford (un bon américain social favorable aux nazis), si les
ouvriers sont mieux payés, ils achèteront des Ford T et cela finira par rentrer
dans la poche … de M. Ford. Les mêmes idées se sont développées en même temps
en France avec André Citroën et Allemagne où Hitler fait construire la
Volkswagen – rappelons que le premier ministre de l’économie du gouvernement nazi
fut le docteur Schacht, un disciple allemand de Keynes. Une fois que le cycle
est mis en route, il doit tourner à vitesse toujours accélérée. Il faut
produire plus pour consommer plus pour qu’on produise encore plus… Ce qui
implique aussi l’effondrement de la valeur des marchandises produites. Pour une
part, cet effondrement est lié au remplacement des objets de la vie courante
par de la camelote. Mais ce n’est qu’une partie et sans doute la moindre de ce
qui se passe. Il faut surtout que de nouvelles marchandises moins chères et
plus attrayantes arrivent sur les marchés à flux continu, donc des marchandises
toujours plus performantes techniquement et une course en avant incessante vers
les « hautes technologies ».
Profitons-en pour dire un mot de « l’obsolescence
programmée ». Cette idée me semble assez mal fondée. Les capitalistes
peuvent se mettre d’accord pour ne pas produire des marchandises trop solides,
pour faire des frigos qui tombent en panne, etc. Et effectivement ils ne se privent
pas de fabriquer des choses à durée de vie brève. Mais dans le même temps, on
sait que la fiabilité de beaucoup de nos biens a fait des progrès énormes (il
suffit de considérer l’automobile pour en être convaincu). L’obsolescence n’est
pas seulement technique : elle est d’abord morale. Un téléphone qui a dix
ans peut très bien marcher, il est pourtant devenu « ringard » et
seuls les vrais snobs peuvent encore sortir avec fierté leur Nokia 2003 ! En outre, la technique fait système – c’est
même sa caractéristique fondamentale – et donc chaque élément du système doit
être accordé avec les autres éléments. Le nouveau logiciel que vous installez
sur votre ordinateur bloque tout alors que, quelques minutes auparavant votre
ordinateur vous rendait de bons et loyaux services. Dans le cas de
l’automobile, où on ne vous installe pas encore une nouvelle version du système
d’exploitation tous les matins, il faut avoir recours aux mesures de l’État
pour éliminer les véhicules qui font de la résistance. Ainsi les mêmes autorités
qui laissent sans contrôle les usines Seveso comme Lubrizol déclarent que telle
voiture pollue trop et doit être envoyée à la casse. Comme la majorité du parc français
était « diéselisée », on a lancé une campagne contre le diesel … au
profit de l’électrique. Demain ce sera autre chose, avec d’autres plans de mise
à la casse. L’obsolescence programmée n’est pas exactement là on a l’habitude
de la situer !
Quoi qu’il en soit, le ressort de nos sociétés est bien la
course à la consommation. Ce qui était bien d’usage devient objet de
consommation. Le jetable est passé des mouchoirs aux produits informatiques (imprimantes,
téléphones portables). Dans Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt
avait noté cette transformation radicale de la condition humaine. À peine
produites les choses doivent être consommées, c'est-à-dire détruites. Mais en
vérité ce qui est consommé, ce ne sont pas seulement les choses produites par
l’industrie humaine, c’est le monde que nous habitons, notre
« écoumène » (pour parler comme Augustin Berque). Combien de milliers
de tonnes de terre faut-il remuer pour obtenir ces précieuses terres rares si
indispensables à nos écrans tactiles ? Combien de paysages faudra-t-il saccager
pour continuer d’installer des éoliennes ? Combien de millions d’hectares
déjà déforestés pour les prétendus « agrocarburants » qui sont
surtout des « thanato-carburants » ? Et combien de millions de
kilomètres carrés d’océan pour nos déchets ? Mais la frénésie n’a pas de
limites : c’est l’humain lui-même qui entre dans le cycle de la
consommation : ovocytes et spermatozoïdes sont des produits commerciaux
comme les autres et porter un enfant un boulot comme un autre. Comme le disait
l’inénarrable Pierre Bergé, parangon de la gauche caviar-champagne, les
travailleurs louent bien leurs bras, pourquoi les femmes ne loueraient-elles
pas leur ventre ? Tout doit tomber dans la sphère de la consommation,
c'est-à-dire de la marchandisation généralisée.
(2)
Dans tout cela, il faut souligner ce que Michel Henry nomme
« inversion de la téléologie vitale » et cette inversion est propre
au mode de production capitaliste. L’échange marchand simple, celui qui découle
de la division du travail dans toute société un peu développée, suit le cycle
M-A-M (marchandise-argent-marchandise). Je produis une marchandise que je vends
contre de l’argent afin de me procurer une autre marchandise dont j’ai besoin.
Au point de départ, il y a l’activité productive, celle du travailleur, et à la
fin du cycle, il y une marchandise qui ne compte pas pour sa valeur mais pour
ses qualités physiques propres à satisfaire un besoin, quelle que soit la
nature de ce besoin, qu’il s’agisse du besoin spirituel (par exemple un volume
d’œuvres des Stoïciens) ou d’un besoin en spiritueux (par exemple une bouteille
de grappa d’amarone !). La vie est au point de départ et elle se retrouve
à l’arrivée. Le mode de production capitaliste, c’est exactement l’inverse. Au
point de départ, il y a l’argent (qui est lui-même du travail gélifié, coagulé
sous sa forme la plus abstraite, puisque la valeur n’est, en dernière analyse,
que du temps de travail) et à l’arrivée il y a de l’argent en quantité
supérieure. Marx symbolise cela : A-M-A’. Au point de départ du travail
mort et à l’arrivée, le caput mortuum du processus, de l’argent,
c'est-à-dire encore du travail mort. Le cycle capitaliste est donc un cycle de
mort. C’est Thanatos, dirait Freud.
Dans ce cycle, la satisfaction des besoins n’est plus la
finalité et la consommation n’est que le moyen qui permet au cycle de se poursuivre.
Le hamster avance pour attraper sa nourriture et ce faisant il fait tourner la
roue dans laquelle il est enfermé. Et ce hamster, c’est nous ! Je crois
que la théorie de Keynes, bien qu’elle soit toujours en faveur dans une partie
de la gauche, repose sur cette idée-là : la relance par la demande
(augmentation des salaires ou investissements publics) n’a pas pour finalité la
satisfaction des besoins ni la justice sociale, mais seulement la poursuite de
l’accumulation du capital. Si les hommes cessent de consommer, c’est toute la
machine qui va se gripper. Les gens qui roulent dans des voitures qui ont plus
de cinq ans ou plus de 100 000 km sont des traitres à la cause sacrée de
la croissance ! On devrait voir ça, dans tous ses effets désastreux,
l’année prochaine, si on en croit les spécialistes de la prédiction économique
– quoique les économistes soient essentiellement des gens très doués pour
expliquer aujourd’hui pourquoi ils se sont trompés hier, selon le bon mot du
regretté Bernard Maris.
Car la consommation n’a pas d’autre but que d’assurer la
croissance ! Le système capitaliste ne fonctionne que tant qu’il peut
assurer, d’une année sur l’autre, de la croissance. C’est là le signe le plus
infaillible que ce système est condamné à moins qu’il ne nous détruise avant.
Un économiste, Kenneth Edward Boulding (1910-1993, enseignant mais aussi poète
et quaker) disait : « celui qui croit qu’une croissance exponentielle
est possible dans un monde fini est soit un fou soit un économiste ». Nous
pouvons tout de suite en conclure que nous sommes dirigés par des fous.
La société de consommation est donc une société où tout est
mis sens-dessus-dessous : la fin devient un moyen et le moyen devient la
fin, ce qui est mort remplace ce qui est vivant, le spectacle remplace le vécu.
Les effets idéologiques sont considérables : puisque la consommation
marche à l’innovation technologique, la technologie devient une force en
elle-même, une force qui formate les esprits. Il est certain que jamais les
machines ne penseront comme les hommes mais il est non moins certain que la
soumission aux procédures machinales peut très bien conduire les hommes à
penser comme des machines.
(3)
Le titre de cette conférence est « La religion de la
consommation ». Après avoir planté le décor, il nous faut maintenant
aborder de front cette question. Pour comprendre comment la consommation
fonctionne comme une religion, il faut encore revenir à Marx et à ses analyses
difficiles mais ô combien éclairantes concernant le fétichisme de la
marchandise. Nous croyons tous que la marchandise est une chose simple, sans
mystère et pourtant elle est bien, comme le dit Marx, une chose
« métaphysique » qui ne cesse de nous jouer des tours. Pour
comprendre ce dont il s’agit, il faut faire un détour par l’anthropologie à
laquelle Marx emprunte le terme de fétichisme. C’est en effet dans le monde
nébuleux des idées religieuses que l’on peut trouver le secret des rapports
sociaux. « Dans ce monde-là (le monde religieux, NDLR), les produits du
cerveau humain semblent être des figures autonomes douées d’une vie propre,
entretenant des rapports les unes avec les autres et avec les humains. Ainsi en
va-t-il dans le monde marchand des produits de la main humaine. J’appelle cela
le fétichisme, fétichisme qui adhère aux produits du travail dès lors qu’ils
sont produits comme marchandises et qui, partant, est inséparable de la
production marchande. »
Stricto sensu, le fétichisme est la croyance que les
choses possèdent une âme, qu’elles peuvent agir sur les hommes. Le fétichisme
est d’abord l’adoration des objets (d’où d’ailleurs l’analyse freudienne du
fétichisme sexuel). Quel rapport entre
le monde de l’économie et l’adoration des objets ? Dans le monde de
l’économie, ce monde dont Marx nous dit qu’il est un monde fantasmagorique, les
choses prennent vie. Une marchandise en effet est une entité double :
d’une part, elle est une chose matérielle, concrète, qui ne vaut que par son
usage et d’autre part, en tant que produit du travail humain elle peut être
échangée sur un marché. Pour tout dire, un objet produit par le travail humain
n’est une marchandise que s’il est destiné à être échangé sur un marché. Dans
l’échange sur le marché se passent deux choses :
1.
Les divers travaux humains qui sont
complémentaires et renvoient à la division du travail apparaissent maintenant
dépourvu de leur caractère social comme des marchandises en concurrence les
unes avec les autres.
2.
Le travail humain qui a produit la marchandise
disparaît, ne reste plus que du travail coagulé ou gélifié, comme le dit Marx, et
la valeur semble maintenant appartenir à la marchandise elle-même.
Il y a une vie « ésotérique », cachée, celle où
les marchandises sont produites par le travail humain, et il y a une vie « exotérique »,
celle de la circulation, là où dominent les marchés et les marchandises, là où
l’on peut oublier ce qui s’est passé dans la « salle des machines »,
avant que la marchandise ne vienne au monde et dans cette « surface »
de la vie sociale, la production sociale des conditions de la vie n’apparaît
que sous le déguisement de la concurrence. La coopération n’y existe que sous
la forme de son contraire ! Voilà pourquoi le monde de l’économie est
littéralement un monde de fous. L’investisseur qui prétend « faire
travailler son argent » ne se distingue en rien, du point de vue des
processus cognitifs, de l’adepte du vaudou qui pique une statuette pour faire
du mal à son ennemi ! Le capitaliste qui soutient que le travail est un coût
met la réalité cul par-dessus-tête puisque c’est précisément le travail qui
produit la valeur.
L’idolâtrie des « marques » a maintenant plus
d’adeptes que les religions idolâtres traditionnelles. Il est d’ailleurs à
remarquer que si la société, jusqu’à nos jours, idolâtre encore les vedettes du
rock ou de la pop, les coureurs cyclistes ou les joueurs de football, il
s’agit, néanmoins, d’humains auxquels on peut s’identifier. Mais désormais, de
plus en plus on idolâtre des choses : la quincaillerie estampillée des
« marques », par exemple. Le « bling bling »
lui-même est devenu autre chose que la consommation de luxe ostentatoire de
jadis. Il ne s’agit pas de porter des lunettes ou une montre coûteuses que
seuls les connaisseurs apprécieront à leur valeur, mais bien d’avoir des
« raybans » ou une « rolex », c’est-à-dire
des marchandises pures, des signes, et non des biens d’usage comme le sont les
objets de luxe dans la société traditionnelle.
Ainsi, le monde des marchandises apparaît-il bien comme un
monde de choses brusquement douées de vie. Mais cette vie n’est pas la
leur ! C’est une vie factice dont l’apparence naît des rapports sociaux de
production, mais ce n’est qu’un monde de fantômes. Cela nous ne le voyons pas,
la plupart du temps, parce que dans l’activité pratique sensible de tous les jours
tout se passe comme si nous n’avions affaire qu’à ces fantômes : les
relations sociales n’apparaissent que sous la forme de l’échange des
marchandises.
Ainsi, chez Marx, l’opposition personnel/impersonnel se
double de l’opposition personne/chose. Si nous rapportons ceci aux catégories
du marxisme standard traditionnel (base/superstructure ou réalité
matérielle/idéologie) nous voyons que la « base », ce sont les
rapports immédiats entre personnes (le procès de travail) et que la
superstructure (l’apparence), ce sont les rapports « impersonnels »
de la valeur. Autrement dit, la base, c’est ce qui est subjectif et la
superstructure, c’est ce qui est objectivé, c’est-à-dire le monde de
l’économie. Voilà ce qui a échappé à nombre de lecteurs distraits de Marx qui
soutiennent que l’économie constituerait l’infrastructure de toute société.
Non, l’infrastructure de toute société c’est la production sociale avec les
modes de coopération et un certain type de rapports déterminés entre l’homme et
la nature et l’économie n’est que la manière dont ces réalités se reflètent
dans le cerveau de hommes.
Comment tout cela se traduit-il dans la conscience des
individus ? C’est précisément cela qui intéresse tout particulièrement
Marx. La conscience spontanée des individus émerge directement du processus de
formation de la valeur. Les marchandises ont un double aspect : elles sont
des valeurs d’usage et des valeurs (d’échange) et ces deux aspects s’excluent
mutuellement (ce que je produis pour l’échanger n’a pas de valeur d’usage pour
moi, mais seulement une valeur d’échange. Les travaux qui permettent de produire
cette marchandise ont cette double nature : pour produite une chaise, il
faut un travail concret particularisé mais quand la chaise est mise sur le
marché, n’y reste que du travail abstrait : cette chaise vaut disons 2 kg
de thé parce qu’il y a dans cette chaise et dans ces 2 kg de thé le même temps
de travail social, la même quantité de travail abstrait. Le « cerveau des
producteurs » – c’est-à-dire le processus de prise de conscience du réel –
reflète ce « double caractère social des travaux privés », producteurs
de valeurs d’usage et producteurs de valeur, mais seulement « sous les
formes qui apparaissent pratiquement dans le trafic, dans l’échange des
produits », bref uniquement sur le marché. Ainsi le cerveau « reflète
le caractère social d’égalité de ces travaux divers sous la forme du caractère
de valeur qui est commun à ces choses matériellement différentes que sont les
produits du travail ». Bref, le travail concret a disparu et ne reste plus
que les valeurs, des quantités pures (exprimables en argent) et qui, seules, intéressent
les « acteurs » de ce marché. Voilà comment les hommes sont amenés à transférer
aux choses les propriétés qui sont les leurs exactement comme ils transfèrent
leur propre être dans la personne imaginaire des dieux.
L’économie politique, telle qu’elle s’est constituée depuis
le XVIIe siècle, porte donc sur une « apparence » que les individus
prennent pour la réalité non parce qu’ils seraient trop peu intelligents, ou
parce qu’ils seraient « intoxiqués » par l’idéologie, mais bien parce
qu’elle est le résultat d’un processus social « naturel ». L’économie
politique, donc, reflète les processus qui constituent la réalité et les
dissimule en même temps. Exactement comme la religion.
Pour Durkheim, la religion est un fait social et même le
« fait social total », dira plus tard Marcel Mauss. Qu’est-ce que
cela veut dire ? Un fait social est un fait suffisamment général dans une
société donnée et qui s’impose aux individus indépendamment de leur psychisme
individuel. La religion est bien un tel fait social. Mais c’est un fait social
particulier qui repose sur la séparation entre le profane (ce qui,
étymologiquement, est devant le temple, pro fanum) et le sacré. La
religion ne suppose pas nécessairement la croyance en un ou des dieux. La
consommation est bien un fait social puisque c’est un fait général (on parle à
juste titre de société de consommation), qui s’impose aux individus
indépendamment de leur propre psychisme. La publicité qui envahit notre monde
annonce le nouvel évangile et conditionne les esprits par la répétition des
slogans comme dans les rituels religieux (dont Freud avait bien montré le
rapport avec les comportements obsessionnels) ou dans les pratiques des sectes.
Mais la consommation fonctionne aussi comme une religion en opposant le profane
et le sacré. Les hypermarchés sont des temples de la consommation où est mise
en scène l’adoration des choses. La possession d’un certain genre de gadget
vaut la possession d’un vrai morceau de la vraie croix du Christ – voir les
pèlerinages devant les Apple Store pour la nativité d’un nouvel
« aï-truc ». Et comme la religion, la consommation vise à combler nos
angoisses mais n’y parvient jamais véritablement (on sait bien que les croyants
ont largement autant peur de la mort que les athées). La frustration ne cesse
de se renouveler et le dieu exige sans cesse de nouveaux sacrifices.
(4)
Vous me direz : certes Dieu n’existe pas mais l’i-phone
existe ! C’est l’ultime illusion religieuse. Ce qui existe, c’est un truc en plastique et
en circuits électronique qui permet éventuellement de téléphoner, de faire des
tas de choses sauf griller le pain et passer l’aspirateur. Mais ça c’est un
très bête téléphone portable. L’i-phone, en revanche, en tant que tel,
n’est qu’une idée, un fétiche. C’est le nom qui compte et pas la matière et du
coup l’i-phone n’a pas de matière, il est une idée pure, un signe. Et un
signe, ça ne téléphone pas ! Exactement de la même façon que « le
concept de chien n’aboie pas ».
Il y a cependant une différence importante entre la
consommation et les religions traditionnelles. Ces dernières reposaient sur la
sublimation : répression pulsionnelle compensée par une satisfaction
narcissique – je suis chaste, je me prive mais Dieu m’aime, moi tout
seul ! Il suffit de lire les Confessions d’Augustin d’Hippone pour
voir, dans une clarté presque aveuglante, que c’est cela le ressort le plus
profond de la foi. Par contre, la consommation ne vous demande pas de vous
priver. Au contraire : il faut donner libre cours à tous vos désirs :
la promesse extatique n’est plus liée à l’abstinence mais au contraire à la
frénésie. Cela fait immanquablement penser à certains groupes gnostiques des
débuts de l’ère chrétienne qui pensaient que l’on devait accélérer la venue de
la fin des temps et donc se débarrasser du corps non par la privation mais par
la jouissance la plus totale.
Mais la consommation n’est pas un remake de la
« révolution sexuelle », une nouvelle façon de jouir sans entrave et
de vivre sans temps mort, selon le slogan fameux du groupe maoïste VLR, dont
l’un des rescapés, Roland Castro est devenu un thuriféraire du pouvoir actuel.
La jouissance n’est plus très bien vue, sauf la jouissance qui implique des
artifices techniques, la jouissance des posthumains en devenir. La consommation
propose bien une sorte de désublimation, mais pas une libération pulsionnelle
incontrôlée, pas le retour triomphant d’Éros, mais une désublimation contrôlée,
soumise au principe de rendement et au ROI (Return On Investment)
capitaliste. Ici, c’est évidemment Herbert Marcuse qui avait très bien vu tout
ce qui se tramait derrière cette société de consommation et on devrait ici lire
ou relire cet excellent auteur de L’homme unidimensionnel ou de Éros et
Civilisation, deux œuvres majeures de notre époque.
De quoi s’agit-il au total ? il s’agit d’un de ces
cultes de la mort dont notre époque a le secret. « Tout doit
disparaître ! » voilà le mantra de la société de consommation. Tout
ce qui est vivant doit mourir soit par destruction pure et simple, soit
par remplacement par une chose inerte. Pourquoi remplacer le vivant par
l’inerte ? Par ce que tout ce qui est objet de consommation est tellement
mieux, tellement plus réussi, tellement plus achevé. Pourquoi manger la viande
d’un bœuf qui n’a pris la peine que d’engraisser tout seul dans son pré, en
broutant de l’herbe qui pousse naturellement ? Il faut remplacer tout cela
au plus vite par un steak artificiel produit par l’industrie chimique. Toute
activité humaine qui peut être remplacée par une machine doit l’être sans
attendre. Même l’intelligence humaine doit céder la place à l’intelligence
artificielle et à ses prouesses. On a aussi produit des programmes
informatiques capables d’écrire des poèmes ou des romans. Là où l’humain met
deux mois ou deux ans ou vingt pour écrire une œuvre, la machine en produit à
la demande et presque autant qu’on le veut.
On faisait des enfants selon la bonne vieille méthode
éprouvée ? Eh bien c’est terminé. Maintenant il faut passer au stade de la
fabrication industrielle, c'est-à-dire remplacer la vie par l’industrie et ça
s’appelle GPA, PMA, etc. Günther Anders évoquait la « honte prométhéenne »,
la honte que nous éprouvons face aux machines. Nous nous sommes vivants
imparfaits, conçus sans plan, héritiers au petit bonheur la chance des gènes de
l’un ou de l’autre de nos parents. La méiose est une véritable horreur !
Les machines au contraire sont conçues pour un but déterminé. Rien de trop,
rien d’inutile dans la machine. Les humains artificiels, les humains mixés avec
des robots, des humains dont la conception aura été réglée seront peut-être
presque aussi beaux que des machines.
La société de consommation va nécessairement avec la
mécanisation du monde, du plus petit détail aux plus colossales machines
intégrées. Mais la mécanique est l’exact opposé du vivant.
Mais le plus radical est la destruction pure et simple. La
société de consommation, c’est bien connu, est une productrice de gaspillages
énormes. Ceux-ci ne sont pas un à-côté pénible de ces magnifiques progrès, mais
la nature même de la consommation en tant qu’elle doit détruire pour que le
cycle du capital puisse se poursuivre. C’est donc une religion
sacrificielle : on sacrifie les prix pendant les soldes parce que tout ce
qui est vendu à prix sacrifié va enfin disparaître. Ici on est encore seulement
dans le symbolique. Mais la dilapidation des biens n’est là que pour marquer ce
qui nous manque, la dilapidation des vies humaines, comme les sacrifices
gigantesques qu’organisaient les Aztèques (Georges Bataille évoque le chiffre
de 20000 sacrifiés par an pour rassasier le dieu Soleil). Nous avons organisé
de grands sacrifices (deux guerres mondiales) et inventé des moyens de tuer en
masse (les chambres à gaz et la bombe atomique). On parle d’holocauste à propos
de la destruction des Juifs d’Europe parce que ce mot désigne un sacrifice où
l’animal tout entier doit se consumer dans le feu. Ce qui manque à cette
société de consommation, ce qu’elle se refuse à faire et qui pourtant la
taraude, c’est de passer enfin aux choses sérieuses et d’en finir une fois pour
toutes avec l’humanité. Marco Ferreri avait produit une fable sur cette société,
La Grande Bouffe (1973) qui avait le mérite non seulement d’être un film
parfaitement dégoûtant mais aussi de dire la vérité de la société de
consommation : le désir d’être mort.
Pour esquisser une conclusion.
La religion de la consommation est parfaitement adéquate au
mode de production capitaliste. Mais elle montre par la même occasion que ce
mode de production ne peut pas durer. C’est une mauvaise plaisanterie que
parler de « développement durable » tant que le moteur de la
production est l’accumulation de capital, c'est-à-dire l’accumulation du
travail mort qu’il faudra régulièrement ressusciter par l’injection du sang du
travail vivant, comme le vampire ne survit qu’avec le sang des vivants.
Comment en sortir ? On ne peut ici donner que quelques
pistes.
1)
Refaire de la valeur d’usage la clé de la
production. Définir l’usage, définir ce dont on a vraiment besoin et produire
pour les besoins. Ai-je besoin d’une voiture qui peut rouler à 200 km/h quand
la vitesse est limitée à 130 (et sans doute bientôt à 120) ? Ai-je besoin
de manger des produits qui ont fait des milliers de kilomètres pour arriver
dans mon assiette ? Si on excepte le café, le thé et les épices, on trouve
tout ce dont on a besoin à portée de main. Il faut simplement réapprendre à
faire la cuisine ! Combien de gadgets pourraient disparaître si on
raisonnait sérieusement ?
2)
Raisonner en termes d’énergie et de matières
premières consommées et non en termes monétaires.
3)
Abandonner la « science économique »
et revenir à l’économie dans son sens premier : l’art de faire des
économies, c'est-à-dire de bien gérer sa maison sans gaspillage.
4)
Au niveau national, planifier, c'est-à-dire
prévoir et investir non en fonction du profit immédiat mais en fonction d’un
plan à long terme – le train plutôt que l’automobile ou l’avion, le commerce de
ville plutôt que les grandes zones d’achalandage, l’agriculture paysanne locale
plutôt que le soja brésilien pour élever des poulets vendus aux pays du Golfe.
La liste est longue et les citoyens seront assez grands pour l’établir
eux-mêmes.
Je me refuse à employer le terme de
« décroissance » parce qu’il nous place dans la même problématique
que la croissance, mais en inversant les signes et parce que la croissance est
absolument nécessaire pour un grand nombre de pays qui ont besoin de voir
croître leurs biens, en eau, en nourriture, en confort, etc. Ceci n’empêche pas
de penser qu’il faudra nous habituer à un peu plus de frugalité, surtout quand
on a déjà tout pour vivre décemment. Mais cette transformation des mentalités
et des manières de vivre n’est possible que si le renoncement aux satisfactions
libidinales de la consommation trouve une compensation, et cette compensation
au moins d’avoir ne peut être qu’un plus d’être. Plus de relations amicales – à
nos jeunes et moins jeunes, apprendre qu’un bon vieux jeu de société en bois et
en carton peut remplacer agréablement les jeux vidéo en ligne – plus de
participation à la vie commune, aussi bien sur le plan politique que sur le
plan culturel : bref une vie mieux remplie que cette vie vide dont on
tente vainement de combler les gouffres par la consommation.
(Conférence au Cercle Condorcet de l'Avallonnais - 13 décembre 2019)