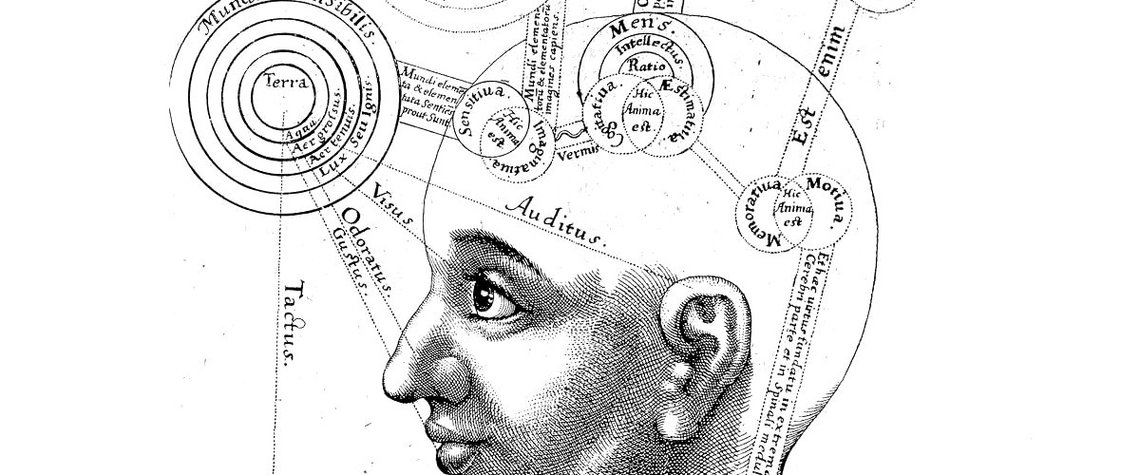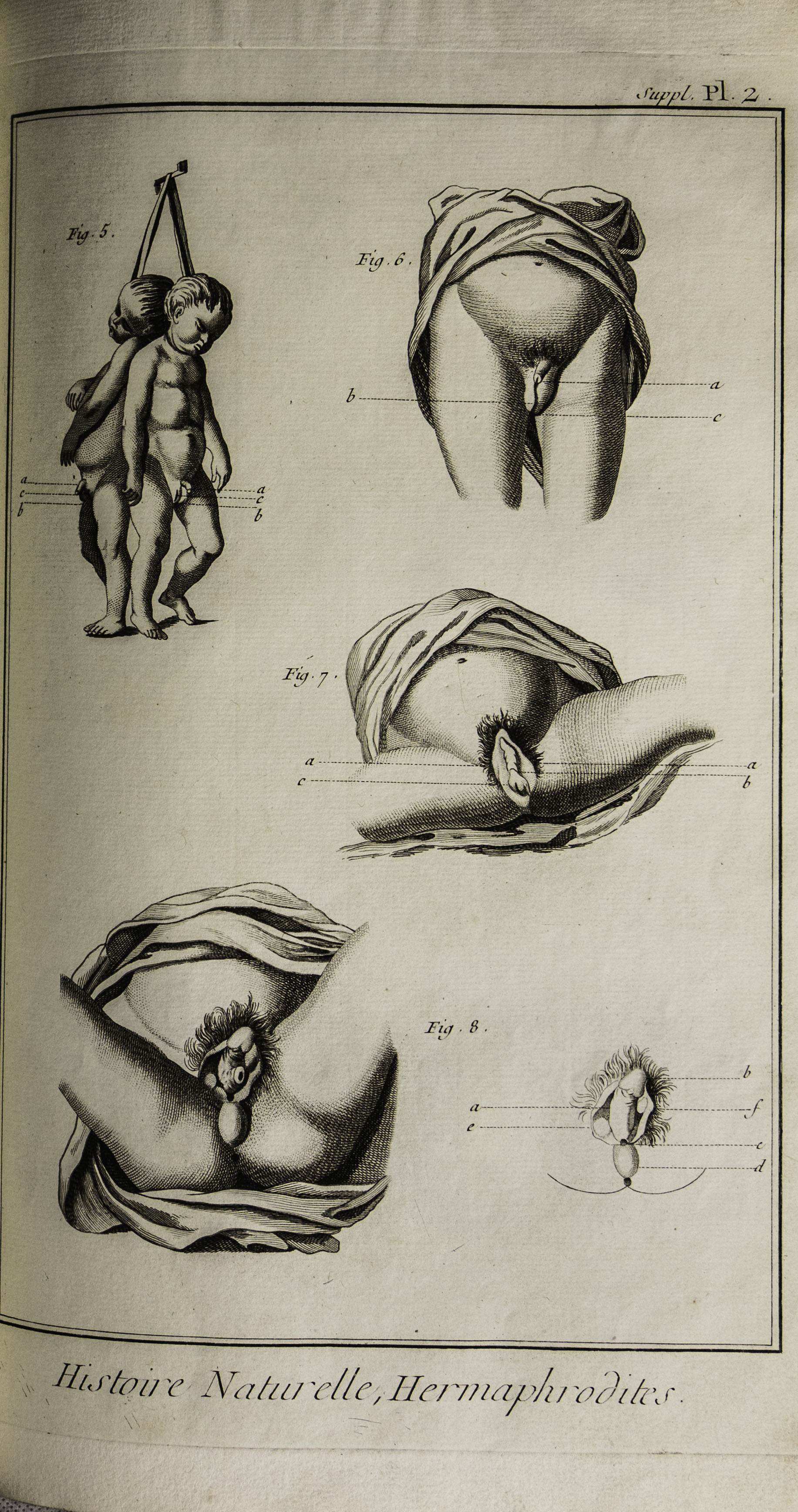Entretien sur la chaîne Sputnik
mardi 21 décembre 2021
mercredi 1 décembre 2021
Science et morale
Si pour les Anciens la science était à la fois la recherche du vrai et celle du bien, dans notre culture apparaît la figure récurrente du savant comme l’être déraisonnable par excellence, le fou ivre de la puissance sur le monde que lui procure le savoir. L’alchimiste dont la science sert la soif de l’or et le voue à la fréquentation du diable, comme son cousin, le docteur Faust, qui vend son âme à Méphisto ; ou le savant moderne, apprenti sorcier qui a déchaîné les forces de la nature et ne peut plus les arrêter – ainsi le Docteur Frankenstein et sa fameuse créature, fruit de l’imagination de Mary Shelley. Nos fantasmes nous apprennent que quelque chose s’est rompu de l’unité de la sagesse antique. La morale (ou l’éthique[1]) et la science ne vont plus du même pas. Notre époque semble vivre entre deux mythes : d’un côté, celui de la toute puissance bénéfique de la science – devenue la référence par excellence d’un monde désenchanté ; de l’autre, la réaffirmation d’exigences morales plus ou moins bien définies comme seule garantie contre cette puissance déchaînée. « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » : ce vieux précepte rabelaisien est censé nous aider à conjurer nos démons. D’où cette volonté qui se manifeste un peu partout de soumettre la science aux exigences morales et d’enseigner un peu d’éthique aux futurs scientifiques.
Cette manière si commune de demander que la science n’ignore point les exigences morales est cependant problématique. Car elle oppose deux de ces « notiones universales » dont Spinoza a montré qu’elles nous donnaient seulement l’illusion d’un savoir. Tout d’abord, la science telle que nous la comprenons aujourd’hui n’est pas la science des Anciens. La séparation de l’être et du devoir, du vrai et du bien est un produit de l’histoire de la philosophie. Ensuite, si la science moderne prône la « neutralité axiologique »[2], elle n’est pourtant pas dépourvue de valeurs morales. Enfin, si conflit, il y a entre science et morale, on pourra se demander si ce conflit concerne la science en tant que telle ou plutôt la puissance sociale dont elle est créditée dans nos sociétés. Autrement dit, nous sommes peut-être devant ce paradoxe que la puissance de la science n’est terrifiante que parce que la science est en réalité asservie à des fins sociales et à des valeurs morales fort discutables.
Le vrai et le bien
Dans l’idée ancienne de la philosophie, la connaissance du Bien paraissait comme le couronnement d’une marche graduelle, d’une dialectique ascendante du savoir. Connaître rationnellement le monde, c’est finalement déterminer la manière juste de se conduire. Il y a là une sorte d’optimisme du savoir que Kant vient mettre à mal. En limitant de manière drastique la puissance de la raison pure, Kant sépare du même coup la science et la morale, la vérité et la norme, la causalité empirique et la causalité de la liberté. La science est privée de toute prétention à dire le bien puisque le bien et le vrai ressortissent à deux usages distincts de la raison. Les seuls résultats auxquels elle puisse parvenir ne concernent jamais la moralité et pour Kant, c’est seulement la raison pratique qui conduit à la connaissance du Souverain Bien.
La scission entre l’usage théorique et l’usage pratique de la raison est la conséquence de la grande mutation de la pensée au tournant du xvie et du xviie siècle. Pour les Anciens, la nature est en elle-même porteuse de valeurs, puisqu’elle est ordonnée en vue de certaines fins ; « la nature ne fait rien vain » répète Aristote. Par conséquent, la connaissance de la nature nous conduit du vrai au Bien. Il ne peut donc pas y avoir de séparation entre l’éthique et la physique. Les Stoïciens « comparent la philosophie […] à un œuf : la partie extérieure est la logique, puis vient la morale, et tout à l’intérieur la physique. »[3] La philosophie est un tout dont chaque partie est reliée aux autres comme le sont les diverses parties d’un organisme vivant. Avec Galilée, Descartes, Spinoza, etc., nous entrons dans un monde bien différent. Un monde qui n’est plus ordonné hiérarchiquement – dans ce monde infini du relativisme galiléen, il n’y a plus ni haut ni bas. Un monde surtout qu’il n’est pas ordonné par des fins suprêmes mais seulement par l’enchaînement aveugle des causes et des effets. Croire que tout dans la nature s’explique par les « causes finales », c’est, pour Spinoza, l’exemple archétypique de toute superstition. Alors que le Bien et le Mal se pouvaient lire dans le « grand livre de la nature », Spinoza affirme maintenant qu’il ne s’agit pas d’absolus, mais seulement de notions, produites par notre imagination, qui n’ont de sens que relativement à nous autres les humains. C’est pour cette raison que la pensée rationnelle, scientifique, doit s’occuper de ce qui est, indépendamment des jugements de valeurs auxquels notre imagination nous porte ; elle doit donc être libre à l’égard des dogmes et des croyances, fussent-ils imposés par les autorités théologiques et politiques.
La morale de la science
Cependant, l’activité scientifique ne se réduit pas à un ensemble de méthode et à un corps de résultats validés. Elle est aussi une activité humaine et comme telle porteuse de valeurs. Il y a une sorte d’éthique de l’activité scientifique définie par la recherche de la vérité comme valeur fondamentale, l’esprit critique, la capacité à se remettre en cause soi-même, la publicité de la recherche, la soumission des résultats à la discussion de l’ensemble de la communauté scientifique, le refus de l’argument d’autorité et la recherche de la conviction rationnelle. Sans doute s’agit-il ici d’une vision idéalisée de la pratique scientifique ; la science réelle ne méconnaît ni les positions de pouvoir, ni le mensonge, ni le secret. Cependant ces critères idéaux sont, à n’en point douter, ceux que revendiquerait tout savant raisonnable.
Autrement dit, la science moderne se constitue en retravaillant et promouvant un corpus d’exigences morales. La pensée des Lumières est entièrement pénétrée de cette idée optimiste : si le savoir et la raison progressent, alors les hommes deviendront meilleurs, ils se débarrasseront des « vaines craintes », chasseront les despotes et apprendront à vivre dans la liberté. Ce que Jürgen Habermas (né en 1929) nomme « agir communicationnel » prend explicitement pour modèle le fonctionnement idéal de la communauté des savants. Habermas y voit précisément la possibilité de substituer aux rapports de domination et de violence, la discussion et la conviction rationnelles entre hommes de bonne foi, débouchant l’acceptation de normes communes de vie.
La neutralité axiologique impose au savant l’objectivité et l’impartialité, mais elle ne signifie pas que la science soit immorale ou puisse en prendre à son aise avec les valeurs morales. La dissimulation est proscrite : « Mais, sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusques à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes » dit Descartes[4]. C’est encore Descartes qui recommande d’user d’une « morale par provision », se conformant aux mœurs en vigueur. Et c’est Darwin qui refuse d’utiliser ses découvertes pour une vaine propagande antireligieuse, estimant qu’il est préférable en cette matière de faire confiance au lent progrès des lumières dans l’opinion. Car la connaissance scientifique n’a pas pour but de donner du pouvoir à celui qui la détient, mais de concourir au bien commun. Cette morale de la science, les médecins, depuis l’Antiquité, en ont donné un modèle avec le serment d’Hippocrate, le premier code de déontologie, qui fixe les devoirs qui vont nécessairement avec le savoir.
Il est d’ailleurs remarquable que l’effort pour fonder en raison notre connaissance de la nature s’accompagne d’un effort pour penser rationnellement la morale. Tant que la morale n’est qu’un ensemble de coutumes fondés sur la croyance dans l’autorité religieuse, elle est condamnée à tomber sous les coups de la critique sceptique. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » dit Montaigne repris par Pascal. Et si « nous sommes chrétiens ou musulmans comme nous sommes Allemands ou périgourdins », que valent donc tous ces préceptes qui règlent les rapports avec les supérieurs, les rituels religieux, les relations sexuelles aussi bien qu’ils commandent l’honnêteté, le respect de la vie humaine ou la foi en la parole donnée ? Le type même de pensée qui caractérise la science conduit à poser la question essentielle : qu’est-ce qui peut fonder la morale en raison ? Car, seule cette fondation rationnelle de la morale peut donner à ses préceptes une valeur universelle.
Certes, la science peut entrer en conflit avec les croyances et les dogmes superstitieux, mais comment pourrait-elle donc entrer en conflit avec une morale fondée rationnellement, une morale qui exprime dans son propre champ, cette même puissance législatrice de la raison qui a si bien fait ses preuves dans les sciences de la nature ?
L’application de la science
Ainsi, en droit, il n’y a aucune raison que la science entre en conflit avec l’exigence morale, tant que cette exigence est elle-même déterminée par la puissance de la raison. Si la séparation claire du champ de la science et de celui de la morale s’accompagne de leur accord fondamental dans la raison humaine, les problèmes naissent du fait que la science moderne n’est pas seulement une contemplation de la nature, elle est d’emblée une volonté de nous en rendre « comme maîtres et possesseurs », selon une expression fameuse de Descartes[5]. Certains contemporains la désignent d’un seul mot qui l’oppose à la science des Anciens : la « technoscience ». En modifiant le milieu naturel de l’homme, la technoscience imposerait aussi, spontanément, ses propres valeurs fondées sur la soumission aux « faits ». Les maximes générales sur le « progrès » qu’on « ne peut pas arrêter » et la nécessité d’y plier nos scrupules moraux sont là pour illustrer cette soumission.
Kant distinguait les sciences pures qui ne visent que la connaissance pour elle-même et les sciences appliquées qui déterminent le développement des techniques. Théoriquement, cette distinction reste parfaitement valable[6]. La formule de l’équivalence de la masse et de l’énergie (« E = mc² ») n’est ni morale ni immorale, puisqu’elle est vraie et il est absurde de rendre, Einstein responsable de la bombe atomique[7] pour avoir énoncé cette formule. On peut même ajouter que la réaction en chaîne est, comme la langue d’Ésope, la meilleure et la pire des choses : elle peut semer la mort ou fournir de l’énergie pour l’industrie et le confort des hommes. Ce qui nous pose problème, ce n’est donc pas la science en général, mais la science appliquée, car, là, il ne s’agit plus de connaissance, mais d’action pratique. Les manipulations génétiques ne sont ni vraies ni fausses ; ce sont seulement des actions qui doivent être jugées, comme toutes les actions, en fonction de critères moraux. C’est bien pourquoi les questions les plus brûlantes concernant les rapports entre science et morale se posent en médecine. La médecine touche d’un côté à la connaissance pure – les médecins travaillent avec les biologistes dans la recherche – et d’un autre côté elle est une science appliquée très particulière puisque son objet est un sujet, l’individu confronté à la maladie et à la souffrance.
Ce conflit entre science et exigences morales, dans l’application de la science, prend deux aspects qui doivent être distingués. D’une part, la science dégénérant en scientisme peut devenir puissance d’oppression et par là même subvertit toutes les valeurs morales. D’autre part, les applications de la science peuvent devenir le champ du conflit non entre science et morale mais entre conceptions différentes de la morale.
Pour le premier aspect, en tant qu’application, la science devient une source de puissance. Suivant une pente naturelle – la raison a toujours tendance à vouloir outrepasser ses propres pouvoirs – s’est développé un état d’esprit « scientiste », c'est-à-dire la croyance selon laquelle les sciences de la nature pourraient donner une solution à tous les problèmes de l’humanité. De là à l’idée qu’on peut traiter des hommes comme des éléments naturels, des insectes ou des vaches, le pas est vite franchi. Le scientiste en vient ainsi à édicter des « règles pour le parc humain »[8] : eugénisme raciste, darwinisme social, etc. Mais ce scientisme, cette idolâtrie de la puissance de la science, constitue une perversion de l’esprit scientifique, que la morale de la science doit rejeter.
Le deuxième aspect est bien plus compliqué. Il s’agit en effet de savoir quelles valeurs morales doivent guider la mise en œuvre pratique des découvertes scientifiques. Si l’application des découvertes scientifiques doit permet de « parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie » et en particulier « aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie »[9], cela signifie que la finalité des applications scientifiques est la maximisation du bien-être humain. Les diverses manipulations du vivant peuvent ainsi trouver une justification morale en tant qu’elles visent à maximiser le plaisir et minimiser les peines, ce qui est la définition même des morales utilitaristes telle qu’elle a été donnée pour la première fois de manière systématique par Jeremy Bentham (1748-1832). Or, il n’est pas évident que le bien commun puisse être réduit à la définition utilitariste. L’utilitarisme a été sévèrement critiqué par Kant et cette critique est reprise aujourd’hui par ceux qui, comme John Rawls (né en 1921), affirment que l’utilitarisme ne peut pas être le principe d’une société bien ordonnée.
L’utilitarisme, en effet, souffre de plusieurs défauts. Tout d’abord, sa conception du bien suprême est extrêmement réductrice – il conduit à une espèce d’hédonisme qui s’oppose à la morale plaçant la valeur de la vie humaine dans des biens plus élevés que le plaisir. Ensuite, il légitime une conception sacrificielle de la vie sociale : des individus peuvent être sacrifiés si cela accroît le bonheur commun. Enfin, il conduit à accepter que l’homme ne soit pas toujours traité comme une fin en soi mais seulement comme un moyen. À l’utilitarisme, on opposera donc les morales déontologiques, qui font de la liberté et des droits de l’individu la valeur suprême et, par conséquent, considèrent notre devoir comme un impératif absolu, cela dût-il nous coûter des peines supplémentaires. Autrement dit, si l’utilité des applications scientifiques est en prendre en compte, elle doit toujours être subordonnée à la considération du respect dû à l’humanité en chaque homme.
Sans développer plus sur ce point, où l’on voit se concentrer les problèmes de l’éthique médicale, nous pouvons donc remarquer qu’il n’y a pas ici conflit entre science et exigences morales, mais conflit entre divers types d’exigences morales.
Conclusion
Il est donc maintenant très clair que la science ne peut pas ignorer les exigences morales. La première question qui nous posée est non pas de soumettre la science à l’éthique, mais de refuser la soumission de la science à des fins sociales immorales. Le problème se pose quand la science ne vise plus prioritairement la connaissance, mais quand elle devient un simple moyen au service de fins déraisonnables, bref quand la rationalité scientifique est transformée en une simple rationalité instrumentale. Du même coup, nous voyons que la question centrale est celle de savoir quelles sont les fins raisonnables qui peuvent donner corps à une morale commune à l’humanité, c'est-à-dire à un ensemble de principes qui garantissent la liberté de tous.
[1] Étymologiquement, ces deux termes sont des synonymes. Devant le grand public, l’habitude a été prise de parler d’éthique, parce que la morale devait faire « vieux jeu ». Plusieurs philosophes contemporains opposent l’éthique – qui concerne la conduite individuelle de la vie – et la morale qui concerne les rapports avec les autres, la première étant particulière et subjective, la seconde étant universelle et objective.
[2] Neutralité quant aux valeurs morales. Max Weber (1964-1920) en fait une des caractéristiques essentielles de l’attitude scientifique.
[3] Diogène Laërce : Vies et opinions des philosophes illustres, vii.
[4] Discours de la méthode, ve partie.
[5] Ibid.
[6] Il y a de bonnes raisons, fondées sur la théorie de l’information, de refuser le concept de technoscience, comme une notion confuse. Voir Jean-Pierre Séris : La technique (PUF).
[7] En tant que citoyen, Einstein s’était adressé au président Roosevelt pour le presser de développer les recherches sur cette arme, face à la menace que faisait peser sur le monde le risque que Hitler possédât le premier cette arme terrifiante.
[8] Titre de la conférence du philosophe Peter Sloterdijk, dans laquelle il examine la situation de l’homme à l’ère des biotechniques.
[9] Descartes : op. cit.
dimanche 28 novembre 2021
Le woke, une arme de guerre contre le marxisme
Le woke, une arme de
guerre contre le marxisme
L’idéologie woke sous ses
divers avatars occupe une place croissante dans l’espace universitaire et
médiatique, multipliant interdits et censures : contre la représentation
d’une pièce d’Eschyle, contre la statue de Colbert, contre les professeurs « mal
pensants ». Les porte-parole de ce mouvement ont table ouverte sur les radios
du service dit public. Comme les vieux réflexes ne se perdent pas, pour dénoncer
le woke, il est parfois de bon ton d’y voir une nouvelle manifestation
d’un marxisme, pourtant mal en point. On peut certes dire du mal du marxisme,
mais s’il est bien une accusation infondée, c’est celle qui en fait le père
putatif du mouvement woke. En réalité, l’idéologie woke est une arme
offensive contre le marxisme (sous toutes ses formes) et contre le vieux
mouvement ouvrier syndical.
Le mouvement woke est
comme le Coca-cola et Halloween, un produit d’importation américaine. Mais ses
origines idéologiques se situent dans la french theory, c’est-à-dire
chez les philosophes français « post-modernes » ou les théoriciens de la « déconstruction »
— un terme qui constitue le principal slogan woke. Or ces penseurs sont
tous des adversaires résolus du marxisme. S’ils adoptent volontiers un discours
« anticapitaliste », ils refusent la centralité de la lutte des classes autant
que la figure de la classe ouvrière comme sujet historique. Chez tous, la
classe ouvrière et ses organisations sont « ringardisées » : trop de
conservatisme, trop de stéréotypes. On leur préférera les schizophrènes
(Deleuze), les « taulards » (Foucault), les minorités, notamment les immigrés
(Badiou destitue très tôt la classe ouvrière française au profit de la figure
rédemptrice de l’immigré), les mouvements féministes, la queer attitude
(encore Foucault). Tous ces courants qui ont fleuri dans les années qui suivent
mai 1968 considèrent, comme Michel Foucault, que la question du pouvoir d’État
comme question centrale est une fausse question et qu’il est nécessaire de
s’opposer d’abord aux « micropouvoirs » et aux « disciplines » qui
domestiquent l’individu. C’est encore chez Foucault et son élève américaine
Judith Butler qu’est revendiquée la nécessité des « identités flottantes »
contre les « assignations sociales » à une seule identité sexuelle. Remarquons
enfin que, comme Foucault admirateur de la « révolution islamique » de
Khomeiny, le woke sacralise l’islam, considéré comme l’allié du
mouvement contre les mâles blancs hétérosexuels, et comme tel inattaquable.
Ces mêmes antinomies se
retrouvent entre marxisme et mouvement woke. Le marxisme est universaliste
et considère que les particularités des différents peuples et des différentes
religions sont appelées à passer à la moulinette du développement mondial du
mode de production capitaliste. Au contraire, le woke est relativiste et
dénonce l’universalisme comme le masque de la domination « blanche ». Marx et
Engels, tout en condamnant les méthodes et les exactions terribles de la
colonisation, y voyaient une de ces ruses de l’histoire grâce à laquelle les
peuples colonisés allaient sortir de leur sommeil et prendre place dans la
lutte aux côtés des autres prolétaires de tous les pays. Ils étaient
franchement européocentristes et considéraient que la civilisation européenne
montrait la voie. Lénine affirmait que le socialisme moderne était l’héritier
de la philosophie allemande, de l’économie politique anglaise et du socialisme
français, lui-même issu des Lumières. Le marxisme a toujours défendu la culture
« bourgeoise », c'est-à-dire la « grande culture », comme
un acquis que devait s’approprier le mouvement ouvrier. On se demande bien
pourquoi les censeurs woke n’exigent pas le retrait immédiat des
ouvrages de ces penseurs horribles.
Les marxistes ne portaient guère
dans leur cœur l’idéologie libérale-libertaire qui s’est déployée après 1968.
En vieux mâle blanc hétéro, Marx condamnait le travail de nuit des femmes comme
contraire à la pudeur féminine. Il ne réclamait pas l’abolition de la morale,
mais dénonçait le capitalisme comme un système qui balayait toutes les
barrières morales ! S’il faut dénoncer les donneurs de leçons de morale, c’est
seulement qu’ils ne mettent jamais leurs actes en accord avec leurs paroles.
Les marxistes sont antiracistes
et antiesclavagistes. Marx rédigea l’adresse de l’Association Internationale
des Travailleurs au président Lincoln, à l’occasion de sa réélection en 1864 et
le qualifia d’« énergique et courageux fils de la classe travailleuse », qui
sera capable de « conduire son pays dans la lutte sans égale pour l’affranchissement
d’une race enchaînée et pour la reconstruction d’un monde social. » La lutte
contre l’esclavage et les discriminations raciales s’inscrit pour les marxistes
dans le sillage des grandes révolutions « bourgeoises » du XVIIIe siècle.
Au contraire, les woke font de la traite négrière une tache indélébile qui
condamne par avance tous les « blancs », oubliant au passage que la plus grande
traite négrière fut organisée par les Arabes et les Ottomans sous le drapeau de
l’islam, avec l’aide active des chefs des peuples d’Afrique qui pratiquaient
eux-mêmes l’esclavage. Ainsi le woke réhabilite le racisme et substitue
la lutte des races à la lutte des classes.
Que les divers mouvements woke
n’aient aucun rapport avec le marxisme et la lutte des ouvriers, il suffit
encore pour s’en convaincre d’écouter ses principaux héraults. Mme Houria
Bouteldja, égérie du mouvement des « Indigènes de la république » ne
déclarait-elle pas que l’ouvrier blanc est son ennemi ? Mme Rokhaya Diallo
est une figure de la « jet set ». Elle est membre de la « classe capitaliste
transnationale ». Mme Traoré est devenue la coqueluche des grandes marques
à la mode. La promotion du lumpenprolétariat et des petits voyous des « cités »
au rang de mouvement révolutionnaire n’a rien à voir avec le marxisme :
Marx et Engels disaient pis que pendre de ce « lumpenproletariat » toujours
prêt à passer au service de la réaction bourgeoise. Étroitement lié aux couches
de la petite-bourgeoisie intellectuelle qui veut d’abord occuper les postes de
ceux qu’il dénonce, le woke est surtout un champion de la « lutte
des places » à l’intérieur de la fraction la plus mondialisée de la classe
capitaliste, celle des médias, du luxe et de la sous-culture marchande. Le woke,
c’est la rébellion aux couleurs de Netflix, Gucci, Louboutin ou Benetton…
On peut critiquer le marxisme :
élève libre de Marx, j’ai beaucoup écrit contre les diverses orthodoxies marxistes.
Mais on ne peut rendre le marxisme responsable du mouvement woke. S’il y
avait encore dans ce pays des marxistes sérieux, nul doute qu’ils seraient à la
pointe du combat contre ces folies qui trouvent dans certains secteurs du
capital une oreille complaisante, peut-être parce qu’elles sont dirigées d’abord
contre les ouvriers, ces « salauds de pauvres », ces « beaufs » qui savent bien,
eux, que le travail reste la question centrale pour nos sociétés.
Denis Collin — 26 novembre
2021
Philosophe. Auteur de Introduction à la pensée de Marx (Seuil), de Après la gauche (Perspectives libres). Site : https://denis-collin.blogspot.com
[Ce texte a d'abord été publié comme une interview dans le Figaro.]
jeudi 4 novembre 2021
Haine des mères
Les mortels : c’est ainsi que les Grecs désignaient les humains. Il est cependant quelque chose d’aussi important pour les désigner : la natalité. Hannah Arendt a bien souligné cette dimension rarement notée. Tous les humains sont nés du ventre d’une femme et le simple savoir de ce fait est la connaissance intime de notre dépendance radicale, de notre contingence ou pour parler comme Sartre de notre facticité.
On a souvent pensé que d’être né créait une sorte d’amour naturel envers la mère (voir Freud) mais on a trop peu souligné l’ambivalence des sentiments. Car il n’est pas agréable du tout de savoir sa propre facticité, de reconnaître sa dépendance, d’apprendre que sa liberté s’élève sur fond de non-liberté. Les filles peuvent trouver une compensation à cette conscience malheureuse dans le savoir qu’elles peuvent devenir mères à leur tour et disposer de ce pouvoir extraordinaire de mettre au monde des nouveaux humains, ces nouveaux qu’il faudra ensuite faire entrer dans le monde. Pour les garçons et pour les hommes rien de tel. La virilité est toujours problématique et la paternité incertaine. L’angoisse de la castration par la mère castratrice, voilà qui explique les méfaits de nombreux malfaiteurs et l’ardeur qu’ont mise les mâles historiquement à réduire les femmes en servitude.
Si l’on suit le rassurant schéma hégélien de la dialectique maîtrise-servitude, tout cela devrait se terminer dans la reconnaissance réciproque et l’égalité. Mais Hegel est le dernier grand philosophe des Lumières et pèche souvent par trop d’optimisme. Surtout ne pas être femme, voilà la réaction que produit aussi chez les femmes la haine des mères, qui devient une terrible haine de soi, laquelle ne peut que devenir une implacable haine des autres. Et c’est sans doute là que l’on devrait rechercher l’origine de ces deux phénomènes en apparence opposés, le retour en force d’un islamisme marqué par une haine des femmes inouïe comme nous le voyons chez les talibans, et la recherche folle d’indifférenciation des sexes, de leur suppression pure et simple, ce qu’exprime la mode du « trans » et les revendications ouvertes de castration de tous les mâles.
Au moment où notre société pue la mort comme jamais, où la vie est déclarée ennemi numéro un, la haine de la natalité des humains trouve naturellement toute sa place. Non pas la haine d’avoir des enfants, mais la haine d’avoir des enfants que l’on n’a pas entièrement contrôlés ab initio. Un enfant fabriqué n’est plus un enfant à naître avec sa redoutable contingence pour la mère et, le cas échéant, le père. Un enfant fabriqué est un produit qui manifeste notre liberté sans loi qui est toujours plus une pure folie.
Il y a là seulement quelques intuitions et quelques pistes pour un programme de recherche pour psychanalystes, historiens et sociologues. Nous sommes engagés dans un bouleversement anthropologique sans précédent et à la clé il se pourrait que l’homme (le genre humain) finisse par s’effacer « comme un visage de sable » ainsi que le prophétisait avec gourmandise Michel Foucault.
mercredi 27 octobre 2021
De la vérité.
« la philosophie est recherche de la vérité »
… « et n’est que cela ». Cette affirmation d’Éric Weil (1904-1977) peut être le fil rouge de l’histoire de la philosophie. La philosophie naît au moment où l’on commence à considérer que la vérité ne vient plus des dieux et des prêtres qui parlent en leur nom, mais peut être découverte par l’homme faisant usage de sa raison. Mais il est très difficile de définir ce qu’est la vérité. Peut-être même est-elle indéfinissable, puisque pour la définir il faudrait déjà savoir ce qu’elle est, en vérité.
ce qui est et ce qui n’est pas n’est pas
La vérité est un énoncé et pour être vrai cet énoncé doit être en accord avec ce dont il parle. « Adequatio rei et intellectus » dit la formule de la scolastique médiévale. Mais le contenu est déjà chez Aristote (384-322). Comment savons-nous que ce qui est est ? Pour Aristote ce sont d’abord nos sens qui nous permettent de connaître la réalité. Certes il arrive que nos sens nous trompent ou qu’ils soient altérés, mais il s’agit là de cas exceptionnels et notre raison nous aide à valider ou non ce que notre perception nous donne. Il n’est rien dans l’intellect qui n’a d’abord été dans les sens, dit encore Aristote. On peut difficilement contester cette définition de la vérité.
Que dire de ce qui n’est pas mais devient ?
Héraclite d’Éphèse (fin VIe sècle av J.-C.)
le constate : dans notre monde, il n’y a de permanent que le changement.
Toutes les choses passent et « on ne se baigne jamais deux fois dans le
même fleuve ». L’universelle mobilité des choses conduit l’homme à juger contradictoirement
de la même chose selon ses sensations. Si tout change en permanence comment
peut-on s’arrêter à une parole ? Parménide (né vers 515 av. J.-C.) résout
le problème à sa manière : la seule parole vraie que l’on puisse prononcer
est « l’être est, le non-être n’est pas ». On ne peut penser que ce
qui ne change pas. Zénon d’Élée, disciple de Parménide développe toute une
série d’arguments pour soutenir ce point de vue qui caractérise l’école des
Éléates. Le philosophe italien contemporain Emanuel Severino (1929-2020) se
considère comme un éléate.
C’est Platon (428-348) qui tente de résoudre le dilemme. La vérité est la propriété des Idées ou des Formes éternelles. Le monde sensible, le monde du changement ne peut être l’objet que de croyances. Les Idées ne sont connaissables qu’à travers une démarche dialectique qui part de l’immédiat pour s’élever à ce qui est intelligible.
Empirisme et rationalisme
Toutes nos idées viennent de l’expérience, soutiennent les
empiristes. Mais la vérité des idées que nous en tirons reste fondamentalement
problématique. Si le soleil s’est levé tous les jours, rien ne prouve qu’il se
lèvera encore demain : telle est la constatation qui soutient le
scepticisme de David Hume (1711-1776). Le rationalisme oppose à ce pessimisme
sceptique la thèse selon laquelle notre raison contient en elle-même un certain
nombre de vérités « innées » qui permettent, si nous en usons selon
la bonne méthode, de nous assurer de la vérité de nos assertions. Descartes
(1596-1650) est généralement associé à ce rationalisme que partagent, avec des
raisonnements et des inflexions différentes Spinoza (1632-1677), Malebranche (1638-1715),
Leibniz (1646-1716) et leurs disciples. Souvent, les mathématiques sont le
modèle de ces vérités qui ne dépendent que du bon usage de notre raison et non
de l’expérience et leur preuve réside dans la cohérence de nos pensées.
Emmanuel Kant (1724-1804) montre cependant que les pouvoirs
de notre raison sont limités. Si nous disposons bien de formes a priori (antérieures
à toute expérience) de la sensibilité et catégories a priori de
l’entendement qui, seules, rendent possible l’expérience, en revanche, notre
raison dans son usage théorique ne peut rien dire de vrai des objets qui ne
sont pas susceptibles d’une expérience possible.
Après Spinoza, G.W.F. Hegel (1770-1831) montre que la vérité n’est pas un résultat mort, mais est entièrement contenue dans le processus qui y conduit. Toute l’histoire de la philosophie elle-même est ce processus global par lequel l’esprit humain acquiert la vérité de lui-même.
Pragmatisme et développements contemporains
Refusant ce qu’il considère comme des vaines spéculations,
le pragmatisme fait de la vérité quelque chose qui découle des interactions
entre les hommes et le monde. Il n’y a pas à chercher des définitions
abstraites des choses, mais des définition opérationnelles, c'est-à-dire qui
induisent des actions qui fonctionnent. De nombreux philosophes peuvent être
rattachés à ce courant, de C.S. Peirce (1839-1914) à Richard Rorty (1931-2007).
La vérité est mise en question par les courants de la
déconstruction : la vérité ne serait qu’un ensemble de constructions
sociales. Dans le champ de la philosophie des sciences est posée la question du
degré de vérité des théories scientifiques et de la possibilité d’établir des
critères de démarcation entre théories scientifiques et théories non
scientifiques.
samedi 9 octobre 2021
Est-ce le cerveau qui pense ?
Nous pensons avec notre tête : « une idée me vient en tête » quand une nouvelle pensée surgit ; « qu’est-ce qui lui est passé par la tête ? » dit-on de celui dont les actes semblent déraisonnables, celui qui a pris sa décision sur un « coup de tête » ; et celui qui réfléchit à un problème difficile « se creuse la tête » ou « se prend la tête ». Cette géographie populaire de nos pensées les fait résider dans le corps. Pourtant, entre ce corps sans vie qu’est celui du mort et le corps vivant, il semble bien qu’existe une différence imperceptible et pourtant essentielle : n’y aurait-il pas une âme immatérielle qui anime ce corps ? N’y aurait-il pas un souffle, un esprit qui lui donne vie et intelligence ? Comment un corps pourrait-il donc penser ? Non seulement les religions mais aussi une très large partie de la tradition philosophique demande que l’on admette l’existence d’un esprit, d’une « chose mentale », indépendante du corps et qui serait la véritable source de la pensée. Est-ce le cerveau ou l’esprit qui pense ? Matérialisme d’un côté, dualisme du corps et de l’esprit, il semble bien que soyons face à deux positions antinomiques, impossibles à départager. Mais peut-être peut-on poser la question autrement ?
I – Avec le développement de la science, nous savons que le
cœur n’est guère qu’une pompe et non le siège des sentiments, l’air respiré par
nos poumons n’est pas un mystérieux principe vital. En revanche, il est évident
que tout ce que nous appelons « pensée » a un rapport direct avec
l’activation des réseaux neuronaux dans le cerveau. Si bien qu’il semble
évident que « le cerveau pense » ou, à tout le moins, que « dans
le cerveau, ça pense ». Du même coup, voilà la pensée qui, à son tour,
déserte le champ de la philosophie, pour tomber dans celui de la neurobiologie.
En effet, il semble parfaitement cohérent avec l’ensemble du
développement des connaissances scientifiques d’affirmer que le cerveau pense.
La science a vocation à connaître selon ses propres méthodes
l’ensemble de la réalité. Or l’homme est une des réalités parmi les plus
intéressantes, pour nous humains ! La science ne peut cependant connaître
que les phénomènes (au sens de Kant), donc des réalités susceptibles d’être
objet d’expérimentation. La pensée, telle qu’en parlaient les philosophes,
n’est pas susceptible d’une autre expérience que cette expérience intérieure,
toute subjective qui nous définit comme des êtres conscients. Le cerveau en
revanche – et notamment avec le développement de l’imagerie médicale –
peut-être l’objet d’une véritable science qui n’est rien d’autre qu’une
spécialisation de la biologie. Dire que « le cerveau pense », c’est
alors résumer la question à ceci : « la pensée, ce n’est rien d’autre
que ce qui se passe dans le cerveau, c’est-à-dire un ensemble de processus
complexes d’activation électriques et chimiques des connexions entre les
neurones.
De ce point de vue, la neurobiologie semble avoir validé les
propositions matérialistes formulées de longue date par tout un courant
philosophique, de l’atomisme antique aux thèses de Diderot dans Le rêve de d’Alembert. À y regarder de
plus près, cependant, les choses sont beaucoup moins simples et le triomphe du
matérialisme en philosophie de l’esprit pourrait bien n’être qu’un
trompe-l’œil.
II – Si on admet que la pensée dépend du cerveau, on
n’a pas, pour autant, démontré que pensée et activité cérébrale sont
identiques. Il faudrait encore rendre compte de ces deux traits essentiels de
la pensée que sont la conscience et l’intentionnalité. L’intentionnalité est le
fait qu’une pensée est toujours une pensée de quelque chose, qu’elle vise
quelque chose. Quand je prononce la phrase « le chat est sur le
tapis », cette phrase a un contenu sémantique. L’énonciation est bien une
activité cérébrale (qui mobilise l’aire du langage), mais c’est une activité
qui porte sur un état du monde (le fait que le chat est ou n’est pas sur le
tapis). Si la pensée n’est qu’un état physique du cerveau, comment un état
physique pourrait-il être « à propos » d’un autre état
physique ? Un état physique peut être causé par un autre état physique,
mais il n’a en lui-même aucun contenu sémantique : les phénomènes
physiques « ne veulent pas dire quelque chose », sauf à retomber sans
une conception purement animiste qui ferait des processus physiques des signes
envoyés aux humains par on ne sait qui ou quoi ! La relation de causalité
physique n’est pas une relation sémantique. Si je vois de la fumée, je pense
qu’il doit y avoir un feu, mais la fumée n’est pas un état physique « à
propos » du feu. C’est seulement un sujet humain qui, utilisant ses
connaissances acquises par expérience, peut penser : « il y a de la
fumée, ça veut dire qu’il doit y avoir un feu quelque part ».
Il apparaît donc que la neurobiologie ne peut donner aucune
description physique de l’intentionnalité de nos pensées. Il n’en va pas mieux
avec la conscience. Quand nous pensons, nous sommes conscients de nos pensées.
Comme le dit Kant « le Je
accompagne toutes mes représentations ». Nos représentations ne nous
laissent pas indifférents ! Or, ni les sciences cognitives, ni la
neurobiologie n’ont réussi à expliquer comment la subjectivité, cette
expérience indiscutable que nous faisons de nous-mêmes, peut émerger d’un monde
de faits objectifs. John Searle, lui-même matérialiste, fait remarquer que nous
ne sommes pas parvenus à expliquer comment la conscience peut être
« naturalisée », même s’il ne désespère pas qu’on y puisse parvenir
un jour.
Nous pouvons, ainsi, d’un côté, admettre que pensée et
cerveau sont inséparables, mais d’un autre côté, reconnaître que nous sommes
incapables de réduire la description des états mentaux à la description des
états physiologiques du cerveau. On peut professer un matérialisme métaphysique
(le monde est un, il est « matériel », infini et incréé) tout en
admettant que les comportements et activités humaines peuvent être l’objet de
deux descriptions hétérogènes, une description en termes d’états physiques et
une description en termes d’états mentaux, sans que l’un des deux niveaux
puissent être défini comme la cause de l’autre.
Il n’est donc peut-être pas nécessaire de revenir au dualisme
cartésien des deux substances pour admettre cependant que « nul corps ne
peut penser » : dès lors qu’on admet que ni la conscience ni
l’intentionnalité ne se peuvent expliquer en termes purement objectifs et
physiques, il faut alors reconnaître que le cerveau – un organe de notre corps
– ne pense pas au sens exact du terme.
III – Wittgenstein tente d’éclaircir cette question dans le Cahier bleu.
« La pensée, disons-nous, est autre chose que la phrase,
car une même pensée s’exprimera en français et en anglais dans des termes tout
différents. Toutefois, du fait que nous
pouvons voir où se trouvent des phrases, nous cherchons un lieu où se
trouverait la pensée. (…)Mais la pensée, direz-vous, existe ce n’est pas un «
rien. » À cela on peut simplement répondre que nous n’utilisons pas du tout le
mot « pensée » de la même façon nous utilisons le mot « phrase ».
Serait-il donc absurde de parler d’un lieu où se situerait la
pensée ? Nullement. Mais l’expression n’a d’autre sens que celui que nous
entendons lui attribuer. Quand nous disons « Le cerveau est le lieu où se
situe la pensée » qu’est-ce donc que cela signifie ? Simplement
que des processus physiologiques sont en corrélation avec la pensée, et que
nous supposons que leur observation pourra nous permettre de découvrir des
pensées. Mais quel sens pouvons-nous donner à cette corrélation, et en quel
sens peut-on dire que l’observation du cerveau permettra d’atteindre des
pensées ? »
Wittgenstein prend l’exemple de la vision. « Ainsi
a-t-on pu dire que l’espace visuel est situé
dans la tête de l’observateur, et je pense qu’on a pu le dire que par une sorte
d’abus de la logique grammaticale du langage. » De la même manière nous
pouvons donc dire que situer la pensée dans le cerveau est tout simplement un
abus de langage.
Par conséquent, l’expression « le cerveau pense »
peut être considérée elle aussi comme un abus de langage. Ce n’est pas que le
cerveau ne pense pas et que ce serait autre chose (le corps, le cœur ou les
poumons) qui pense ! C’est tout simplement que, strictement parlant un
cerveau ne peut pas plus être dit « penser » qu’un ordinateur ou un
distributeur automatique de café. La pensée n’est pas un prédicat possible pour
une chose physique. Mais il n’est sans doute pas possible non plus de dire que
c’est l’esprit qui pense, si on entend par « esprit » une entité
particulière distincte du corps – ce serait revenir à un dualisme dont les
complications sont trop connues : comment comprendre l’interaction entre
substance matérielle et non pensante et une substance pensante et non
matérielle ? Une pensée est une « chose mentale » qui a un
contenu, ce contenu pouvant être une image d’une chose physique … ou d’une
autre chose mentale.
Évidemment, cette façon de voir les choses n’est pas agréable
pour ceux qui pensent qu’on peut faire une théorie du tout, qui serait
finalement une physique. Mais c’est la seule manière que nous ayons de rendre
compte du fait que nous parlons et que nos paroles prétendent à la vérité. Si,
en effet, nos pensées n’étaient rien d’autre qu’une appellation pour des
processus physiques, il n’y aurait aucun sens à dire qu’elles sont vraies ou
fausses : on pourrait seulement se demander si telle pensée est une
réponse adaptée de l’individu dans des circonstances données. Mais une telle
conception renonce à l’idée de vérité, car une erreur peut être une réponse
adaptée…
Pour autant, il n’est pas complètement insensé de dire que le
cerveau pense, si par là on entend qu’il y a corrélation entre pensée et
activité cérébrale. Cependant, du point de vue qui nous importe, c’est-à-dire
du point de vue l’intelligibilité des comportements humains, ce genre de
proposition n’est pas d’une grande utilité. Quand un individu est malheureux
parce qu’il a perdu un être cher, on constate que son état cérébral se modifie,
que les neurotransmetteurs qui assurent la régulation des humeurs n’accomplissent
plus leur fonction correctement. Cependant, on ne peut pas dire que c’est son
état physique qui est en cause, c’est bien ce sentiment de la perte qui est la
cause du malheur. Autrement dit, même si on admet que le « cerveau
pense », c’est une proposition finalement vide puisqu’elle n’apporte aucun
gain d’intelligibilité, puisqu’elle ne permet pas de dire quelque chose de plus
intéressant que ce que la psychologie populaire nous dit.
Conclusion – Au dualisme cartésien de l’âme et du corps, il
s’agirait alors d’opposer un monisme un peu particulier : il y a bien une
seule réalité humaine, mais que l’on peut décrire de deux manières, soit
physiquement comme n’importe quelle réalité physique – la physiologie du
cerveau incluse – soit mentalement, sans que l’on ne puisse jamais éliminer une
de ces descriptions au profit de l’autre.
mardi 5 octobre 2021
« Transgenre » : un post-humanisme à la portée de toutes les bourses
Si on en croit certaines statistiques, les demandes d’opérations en vue d’un changement de sexe ont fortement crû au cours des dernières années. Aux États-Unis, les opérations officiellement reconnues auraient augmenté de 20 % en 2016 par rapport à 2014 pour atteindre 3500 cas, mais ce chiffre ne décompte pas, loin de là, toutes les opérations qui seraient environ cinq fois plus nombreuses. Les compagnies d’assurance d’ailleurs proposent de plus en plus la prise en charge des opérations de « réassignation de sexe » qui découlent de ce que les psychiatres nomment « dysphorie de genre » (pour rester dans la langue politiquement correcte). En France, désormais les opérations de réassignation de sexe sont prises en charge (sous condition) par la Sécurité sociale. Il y a une sorte de banalisation de ce qui, il y a peu, était réservé à quelques individus, dans une certaine semi-clandestinité. Des changements importants s’opèrent donc qui ne sont pas seulement médicaux, mais affectent la sphère sociale et les idéologies. Les travestis faisaient partie d’un paysage social interlope : travestis au théâtre — pendant longtemps les rôles de femmes étaient tenus par des hommes — ou travestis des milieux prostitués. Le cinéma en fait un de ses thèmes de prédilection. Dans Victor, Vitoria, Julie Andrews joue le rôle d’une femme qui se déguise en homme qui se travestit en femme ! Les travestis jouent un rôle important dans le cinéma de Pedro Almodovar. Le chevalier d’Éon a longtemps fasciné les historiens et surtout les amateurs d’histoire. Dans tous ces exemples, on reste dans le jeu, dans le rôle qu’on cherche à endosser. Avec les opérations de changement de sexe, il s’agit d’autre chose, il s’agit d’une rupture profonde qui s’inscrit dans un ensemble de recherches, de tentatives plus ou moins folles devant permettre à l’homme de se modifier lui-même, de se transformer non dans les apparences, dans le jeu social, dans les mœurs (bonnes ou mauvaises), mais dans son être biologique, dans le substrat même de son existence. La banalisation du changement de sexe est ainsi le point d’entrée dans le post-humain. C’est à ce titre qu’il y a là un enjeu essentiel.
En premier lieu on devra clarifier la terminologie et
déterminer précisément ce que recouvre la vaste étiquette « trans », en évitant
soigneusement tout amalgame. On essaiera ensuite de déterminer les causes de la
demande « trans » et ce qu’elle indique de l’état affectif de la société
contemporaine. Enfin, on tentera de définir quelques pistes à la fois
concernant la logique de ce qui est engagé et les principes normatifs qui
permettraient éventuellement d’y résister.
Qu’est-ce que le trans ?
Le préfixe « trans » indique la traversée, le passage d’une
rive à une autre (transatlantique) ou la mise en relation d’entités
ordinairement séparées (les mouvements transgénérationnels). Le transhumanisme
est ainsi la mise en communication de l’homme et des machines permettant
l’avènement du post-humain. Le transgenre n’est pas très clair : il s’agit
non pas de souligner ce qui est commun aux genres masculins et féminins, mais
bien plus de refuser la séparation homme/femme (séparation assimilée à une
pensée « binaire ») et de permettre le passage de l’un à l’autre en soutenant
la fluidité des identités de genre – fluidité parfaitement en accord avec les
analyses de Zygmunt Bauman sur la société liquide ![3]
Mais si on admet, ce que demandent les théoriciens des gender studies, qu’il est nécessaire de distinguer le genre, comme
construction sociale, du sexe, comme construction biologique, alors le
transgenre n’est pas du tout l’équivalent du transsexuel, même si la frontière
entre les deux catégories est loin d’être étanche. Le transsexuel est celui qui
cherche à mettre en accord son sexe biologique et le genre qu’il pense devoir
assumer. Le transsexuel se fait opérer, renonce, pratiquement définitivement, à
tout ce qui pourrait le rattacher à son sexe de naissance pour se faire
greffer, autant que possible les attributs de l’autre sexe.
Psychanalytiquement, on pourrait dire que le transgenre est
celui qui manifeste tous les traits d’une névrose, mais ce terme est inadéquat.
Si la névrose est le symptôme d’un conflit entre le ça et le surmoi confiné à
l’intérieur du Moi, le névrosé ne perd pas le lien avec le réel. Il est
conscient de sa souffrance peut trouver dans la psychanalyse le moyen de
rechercher la vérité de sa souffrance et de s’en libérer ou du moins de la
placer sous contrôle. Dans la « dysphorie de genre », le lien avec le réel est
largement perdu. Ce qui veut changer de sexe, pense « réellement » être une
femme dans un corps d’homme ou inversement et loin d’introjeter ce conflit
(comme dans la névrose), il le projette en exigeant de la technique qu’elle
satisfasse son désir. Il y a là-dedans quelque chose qui ressemble à l’illusion
délirante (je me prends pour une femme comme d’autres se prennent pour
Napoléon), ou encore à la perversion narcissique dont Freud identifie l’origine
dans les troubles de l’identification de sexe et que Lacan ramènera clairement
à la « crise œdipienne ». Il y a de nombreux débats, à l’intérieur du mouvement
psychanalytique au sujet de la dysphorie de genre, mais comme les institutions
ont décidé que ce n’était pas un trouble psychique, mais un désir aussi normal
que la faim ou la soif, ces débats se font maintenant à voix basse pour éviter
de tomber sous les coups de la « phobophobie » ambiante.
Aujourd’hui militants comme psychiatres prônent l’abandon du
terme de transsexualité au profit du transgenre ou du transgenrisme, c’est-à-dire
tout ce qui concerne les transidentités, afin de prendre en compte tous les cas
de figures multiples. Un homme peut décider de devenir une femme lesbienne ou
une femme un homme gay, « l’identité sexuelle psychique » ne coïncidant ni avec
le sexe biologique (XX ou XY) ni avec l’orientation sexuelle (on hésite à
employer ce terme). D’ailleurs on n’a même plus le droit dire que Untel ou
Unetelle est né homme ou née femme, on doit dire « assigné à la naissance comme
homme ». Pour que personne ne soit oublié, on multiplie les catégories, puisque
ce trouble dans les identités déclenche une manie de la classification et de la
réidentification. Ainsi les LGBT (lesbienne, gay, bi et trans) doivent-ils (ou
elles ?) s’ouvrir aux « queers »
(ceux qui sont entre les deux), aux « agenres », etc. Ce qui est le plus
intrigant, c’est la maladie de la classification qui, au contraire de ce que
prétendent ses promoteurs, n’est rien d’autre qu’une essentialisation des
conduites.
Il y a pourtant une distinction importante à faire :
les travestis ne font que se déguiser, même s’ils usent des accessoires
féminins. Ils ne deviennent homme ou femme que sur le plan fantasmatique. Le transgenre
qui procède à une « réassignation » commence au contraire à se modifier
biologiquement. Et c’est un renversement radical de perspective. Toute la
théorie du genre repose sur la séparation du genre (sexuation psychique) et du
sexe biologique, mais les transformations de leur propre corps auxquels se
livrent les transsexuels ont pour but au contraire de rendre le corps sexué
identique au sexe psychique. Les « vrais » trans sont donc une réfutation
vivante par l’exemple de la théorie du genre ou de ce que les Américains
appellent « queer theory ».
Comment transforme-t-on un homme en femme ? Il y a plusieurs phases et plusieurs
techniques. La plus simple suppose une féminisation des traits visibles :
visage, cheveux, hanches, travail de la démarche, pilosité… Il est assez facile
pour un garçon aux traits féminins d’effectuer cette première transformation
qui reste réversible, mais demande un soin constant. On peut ajouter un
traitement hormonal et la chirurgie plastique pour fabriquer des seins. Mais il
n’y pas encore eu de changement de sexe à proprement parler. Ces transsexuels
(ceux que l’on peut voir dans les films pornographiques) sont en fait des
hommes qui peuvent se faire passer pour des femmes tant qu’ils ne sont pas
complètement nus. Ils continuent d’avoir des érections et des éjaculations
parfaitement masculines. Si cet individu masculin a une orientation lesbienne,
il (ou elle) peut devenir père biologique d’un enfant que porterait son amie (c’est
le thème d’un film d’Almodovar) et s’il séduit un homme, il ne peut évidemment
pas avoir les mêmes relations sexuelles que s’il était une femme.
La phase suivante consiste en une ablation des organes
sexuels masculins, testicules et pénis, et, au moyen d’une chirurgie plastique
assez lourde, on peut utiliser la peau du pénis pour fabriquer un
pseudo-clitoris et on sculpte un pseudo-vagin (vaginoplastie). L’individu qui a
subi ce traitement ne pourra plus redevenir qui il était. Mais il n’est pas pourtant
devenu une femme. Son pseudo-vagin ne se lubrifie pas naturellement et son
pseudo-clitoris n’est pas un clitoris.
Comment une femme devient-elle un homme ? C’est en gros le
même processus, mais en sens inverse. Dans une première phase, seuls les traits
extérieurs normalement visibles sont altérés, mais à condition d’engager
presque tout de suite des interventions chimiques (traitements hormonaux) et
chirurgicales (ablation des seins). Mais jusque là elle reste une femme. Une
femme à barbe, une femme qui a l’air d’un homme, mais une femme tout de même. Et
elle peut toujours mettre au monde un enfant (ces cas font la joie de la
presse). C’est seulement avec l’ablation des organes féminins et la
phalloplastie que la transformation devient irréversible (ou presque). Pour que
ce pseudo-pénis devienne érectile, il faut attendre entre 12 et 18 mois
pour pouvoir greffer un « pénis érectile » qui n’est qu’un organe mécanique
implanté à l’intérieur du pseudo-pénis et permettant à notre femme devenue
homme d’avoir des érections — mais évidemment pas d’éjaculation.
En ce qui concerne le plaisir sexuel, la littérature sur le
sujet est des plus confuses. Personne ne s’avise d’affirmer que les rapports
sexuels d’un trans opéré ou d’une trans opérée sont aussi satisfaisants que
peuvent l’être les rapports sexuels d’individus non opérés. Toutes sortes de
périphrases sont utilisées pour contourner la question : la jouissance est
affaire très subjective et personne ne sait comment jouit l’autre, etc. « On a
des sensations et c’est déjà bien », dit l’une. Il se pourrait bien que cette « réattribution »
ou cette « réassignation » sexuelle soit un leurre et certaines études font
état de 60 % de transopérés qui regretteraient cette opération — bien que
les chirurgiens spécialistes de ces opérations affirment de leur côté que leurs
patients vont presque tous très bien et ont une vie sexuelle satisfaisante. On
note aussi un grand nombre d’états dépressifs. La « réattribution » qui devait
résoudre un mal être pénible semble ne rien résoudre. Il y a peu de données
fiables concernant les tentatives de suicide après opération. Certains sites
évoquent des taux 20 fois supérieurs à la moyenne, sans citer de sources.
Mais Le Monde, favorable à tout ce
qui est moderne, concède que le taux de suicide reste très élevé après
l’opération, en partant du fait évident que les trans sont des gens plutôt
suicidaires avant l’opération. On peut donc supposer que l’opération n’a que
des effets très faibles dans le meilleur des cas, sur le mal-être des trans.
Il est évidemment interdit de dire que la dysphorie sexuelle
— c’est-à-dire le désaccord entre le sexe biologique et le psychisme — est une
maladie. Pour éviter cette conclusion qui s’impose à quiconque regarde les
choses avec un minimum de bon sens, on s’interroge aujourd’hui sur l’origine
génétique de la dysphorie sexuelle. Mais si c’est une question génétique alors
la réattribution de sexe (ou de genre) serait simplement une correction d’une « erreur
de la nature » ! Une des conséquences très gênantes pour les théoriciens du
genre, c’est qu’il faudrait admettre que nous n’avons pas affaire à des
constructions sociales, mais bien à quelque chose qui s’enracine dans le
biologique. Donc être homme ou femme n’est pas une affaire biologique, mais
être trans l’est. Toutes ces prétendues théories du genre flottant,
non-binaire, etc., ne sont en vérité qu’un bric-à-brac inconsistant, au
verbiage prétentieux, mais fort utile pour faire commerce de la détresse
humaine.
Ne pas confondre transgenre et homosexualité
C’est une erreur commise couramment, par les intéressés
eux-mêmes parfois : on confond volontiers transgenres et homosexuels et la
transphobie et l’homophobie sont volontiers mises dans le même grand sac des
phobies qu’il faut chasser partout où elles se manifestent. Pourtant
homosexualité et dysphorie sexuelle sont très différentes. Les homosexuels sont
des personnes attirées par le même sexe qu’elles et non pas attirées par le
sexe opposé alors que sous un certain rapport le transgenre est d’abord celui qui
ne se réalise sous une forme fantasmée que dans la représentation du sexe
opposé. Un homme homosexuel n’est pas spécialement efféminé et la vieille image
de la « tante » ou de la « grande folle » colle encore à la peau des
homosexuels assimilés aux « invertis ». S’il en ainsi, c’est en partie parce
que le jeu des apparences permettait justement de déguiser le rapport
homosexuel en rapport normal. Si dans un couple homosexuel l’un joue un rôle
féminin et l’autre un rôle masculin, c’est précisément ce qui permet de
renormaliser l’anormal et d’éviter d’avouer que ce qui fascine dans l’autre du
même sexe, c’est justement la mêmeté.
En vérité, ceux qui assimilent l’homosexualité et
l’inversion des sexes raisonnent en considérant que la seule sexualité digne de
ce nom est l’hétérosexualité et c’est pourquoi il faut à tout prix retrouver
une séparation des rôles, des stéréotypes hétérosexués jusque dans le rapport
homosexuel. Pourquoi un homme préfère-t-il sodomiser un autre homme ? A-t-il
vraiment besoin de l’illusion que l’autre est une femme ? Évidemment, non ! La
pratique grecque de la pédérastie qui n’est pas à proprement parler une
pratique homosexuelle, puisqu’elle ne concerne que les mâles adultes se liant
d’un amour sodomite avec des jeunes adolescents pubères (mais pas encore trop
barbus), est une pratique très particulière dans laquelle on ne retrouve en
rien l’inversion des sexes plus ou moins déguisée. Une femme n’éprouve pas de
désir envers une autre femme au motif qu’elle la trouverait « masculine » ou
qu’elle-même se sentirait comme un « garçon manqué », mais tout simplement
parce que cette autre femme sollicite son désir de femme.
Risquons encore une autre hypothèse. Toutes les sociétés que
nous connaissons ou presque considèrent que l’homosexualité est « contre nature »
ou ne serait qu’une particularité de certains individus qui seraient nés « avec
ça » et différeraient ainsi du cas général par une sorte de « difformité »
congénitale — ce qui est l’explication la plus courante des défenseurs de
l’homosexualité. Et pourtant, on pourrait faire l’hypothèse inverse. Si on
admettait avec Freud que la sexualité humaine est originellement « polymorphe »,
s’il n’y a pas à proprement parler d’instinct sexuel, mais des pulsions qui se
lient à des objets dans une histoire individuelle, on pourrait penser que
l’interdit de l’homosexualité est un interdit social culturel construit par les
sociétés pour diriger la sexualité vers la reproduction et en inhiber toutes
formes non conformes aux besoins sociaux. Il n’y a pas plus d’aversion « naturelle »
pour l’homosexualité qu’il n’y a d’aversion « naturelle » pour l’inceste. Au
demeurant, si l’homosexualité était « contre nature », il ne serait nullement
nécessaire de l’interdire ou de la réglementer. Freud nous met sur la voie
quand il écrit : « Nous sommes obligés de voir dans l’homosexualité une
excroissance à peu près régulière de la vie amoureuse, et son importance
grandit à nos yeux à mesure que nous approfondissons celle-ci » (Introduction à la psychanalyse), mais il
ne semble pas en tirer toutes les conséquences.
La position que nous proposons de tenir est qu’il n’y a
aucune essence homosexuelle, que personne ne peut dire absolument « je suis gay »
ou « je suis lesbienne » comme on dit « je suis Français » ou « je suis né dans
le village de Saint-Martin » ! L’homosexualité est une pratique sexuelle,
éventuellement une manière de vivre, mais nullement un genre d’être. Ce que
nous tenons de la nature, ce sont seulement des organes sexuels et des réseaux
neuronaux et hormonaux qui commandent la jouissance, mais leur usage en est
éduqué par la vie sociale et c’est cette éducation sociale de la sexualité qui
est maintenant condamnée comme discriminatoire par les défenseurs de
l’idéologie LGBT+etc.
Très curieusement, au moment où l’on répète à tort et à
travers qu’on ne naît pas homme ou femme, mais qu’on le devient, voilà que les
LGBT+etc. soutiennent qu’en quelque sorte on naît homosexuel ! Le genre
finalement n’est pas aussi troublé que le dit Mme Butler et que le
répètent ses sectateurs. L’essentialisation de l’homosexualité qui paraît si
absurde est maintenant utilisée pour justifier l’intervention de la médecine et
de la chirurgie esthétique dans les opérations de « réassignation de sexe » au
motif que le corps ne correspond plus à nos fantasmes.
Mais le fantasme par définition ne correspond pas au corps,
sinon ce ne serait pas un fantasme. On pourrait donc conclure que les
transsexuels, au moins pour une partie d’entre eux, seraient des homosexuels
honteux de l’être qui veulent faire correspondre leur apparence physique à leur
fantasme et dans ce but ils demandent une opération qui transformera toute leur
sexualité en un pur fantasme, car une femme devenue homme ne jouira jamais
comme un homme même avec un pénis gonflable ; et un homme devenu femme ne
jouira jamais comme une femme même avec un faux clitoris en peau de gland.
Mutilations sexuelles
Les opérations portant sur le sexe ne sont pas une invention
récente. On a longtemps castré les hommes (esclaves eunuques, jeunes castrats
pour les chœurs pontificaux) et les femmes de l’excision à l’infibulation jusqu’aux
surcharges hormonales des nageuses de l’ex-RDA ont payé un lourd tribut à la
volonté des puissants de ne pas se laisser arrêter par les barrières fixées par
« l’assignation sexuelle ».
Si on se dégage des normes du politiquement correct qui
prescrivent de ne jamais critiquer les opérations de réattribution de genre et
qu’on essaie de caractériser objectivement ce qui est en cause, il faut appeler
ces choses-là par leur nom : mutilations sexuelles. Supposons que
quelqu’un ait envie d’avoir une jambe plus courte que l’autre ou de se faire
greffer une main sur le ventre, on pourrait penser qu’on ne trouverait pas un
chirurgien pour aller triturer des organes sains avec son bistouri dans le seul
but de réaliser les fantasmes d’un « client ». En fait si : on trouve des
chirurgiens, bardés de « bienveillance » prêts à se lancer dans ces opérations
dont on pourrait se demander si elles sont bien conformes au serment
d’Hippocrate. Les opérations de « réassignation de genre » sont un bon business
qui dispose de la bénédiction des autorités politiques, des autorités morales,
notamment de la « gauche culturelle » et de notre Sécurité sociale qui a
pourtant beaucoup de mal à rembourser les vrais malades et notamment un certain
nombre de pathologies lourdes. Et pourtant émasculer quelqu’un, ou lui coudre
les grandes lèvres, même à sa demande, c’est bien une mutilation sexuelle, au
même titre que la castration, l’infibulation ou l’excision. La question du
consentement, au cœur de toutes les justifications des partisans de la « morale
minimale » à la Ruwen Ogien[4],
ne peut être invoquée. Si je tue quelqu’un à sa demande, je serai inculpé de
meurtre et j’aurai beau plaider le consentement de la victime, je mériterai
d’aller faire un tour en prison. Si je mutile quelqu’un à sa demande, il en ira
de même. Un film, projeté il y a quelques années sur Arte, narrait l’histoire
d’un masochiste qui demandait à son kiné de lui briser les membres pour finir
par le tuer. Tel était le bon plaisir du souffrant ! Admettrons-nous que cette
fiction devienne une réalité ?
Jusqu’à nouvel ordre en France l’excision est interdite et
conduit les « praticiens » devant la justice pénale. On pourrait faire
remarquer que cette barbare ablation permet d’insérer les filles dans leur
communauté, qu’elle est une tradition culturelle comme les autres et aussi respectable
que les autres, etc., et demander la dépénalisation de l’excision, ce qui fut
une revendication portée par l’ethnopsychiatrie et notamment par Tobie Nathan. Si
on pose cette question, on peut espérer que les LGBT+ en tous genres se
prononceront contre l’autorisation de l’excision — encore que l’évolution des
mentalités au cours des dernières années rende cette réponse problématique (le
relativisme culturel venant au secours de la barbarie). On alléguera que les
petites filles excisées ne sont pas consentantes et que c’est une différence
majeure. Ce n’est pourtant pas certain.
D’une part le consentement n’est pas toujours un argument.
Bien que dans la morale minimaliste des individualistes libertariens (à la
manière de Ruwen Ogien) le consentement individuel soit l’alpha et l’oméga de
la loi, c’est juridiquement intenable. La prostitution devrait être légalisée
selon les minimalistes moraux dès lors qu’il s’agit d’une occupation à laquelle
consentent librement les prostituées et prostitués qui sont transformés en « travailleurs
du sexe ». De même la location d’utérus (mères porteuses ou, plus correct
politiquement, GPA) devrait être légale dès lors que les femmes qui se décident
à porter le bébé d’un autre ou d’une autre sont consentantes et que leurs
intérêts pertinents sont pris en compte. Les « mauvais esprits » remarqueront
que les violeurs affirment généralement que leurs victimes sont consentantes. En
outre, on a de bonnes raisons de refuser aussi bien la transformation des
prostituées et prostitués en simples travailleurs du sexe que la GPA. D’une
part parce que le consentement réel de la personne ne peut jamais être
garanti : quand une femme pauvre se prostitue ou loue son utérus, est-ce
vraiment d’un libre consentement ? On voit rarement les femmes riches se
prostituer ou louer leurs services dans le cadre d’une GPA ! Plus généralement,
on se fait rarement exploiter de son plein consentement — je suis tout prêt à
admettre qu’il y a des prostituées qui le font par plaisir et que certaines
femmes adorent être enceintes, mais ça me semble des cas exceptionnels ou des
rationalisations a posteriori.
En second lieu, la loi peut légitimement interdire certains
actes auxquels une personne consent. Si, par exemple, je demande à quelqu’un de
me tuer, celui qui me tuera devra cependant être poursuivi pour homicide. Si je
vois quelqu’un sur le point de se suicider, je dois intervenir pour l’en
dissuader ou l’en empêcher par la force, faute de quoi je devrai être poursuivi
pour non-assistance à personne en danger. On peut le regretter, mais je n’ai
pas non plus le droit de me « défoncer » à l’héroïne ni même de refuser à
l’avance de cotiser à l’assurance maladie au motif que je ne veux jamais avoir
affaire aux médecins et que je préfère mourir. Au moins dans une certaine
mesure, je n’ai le droit ni de regarder passivement quelqu’un se faire du tort
à lui-même ni de me faire du tort à moi-même. On peut discuter de la fameuse
thèse kantienne concernant les devoirs que l’on se doit à soi-même, et elle ne
doit certainement pas être appliquée de manière absolue et mécanique — mais
c’est vrai de tout précepte moral — mais elle reste un cadre moral et juridique
pertinent.
Quoi qu’il en soit, on peut certes se faire du mal à
soi-même, se mutiler, se suicider, etc., mais ce ne peut pas être un droit, et
a fortiori un droit exigible et remboursé par la sécurité sociale ! On
objectera que les opérations de changement de sexe (pardon, de genre !) sont
non seulement consenties, mais permettent à l’individu de trouver son bien. Cet
argument est également très contestable. D’une part, que quelqu’un croie
trouver son bien avec un certain moyen, ne signifie pas qu’il trouvera
réellement son bien. L’expérience montre, comme on l’a dit, que de nombreux
opérés en vue de la « réattribution de sexe » sont loin d’y trouver leur bien.
D’autre part, que quelqu’un croie trouver son bien dans une mutilation ne
signifie pas qu’une personne extérieure, a fortiori un médecin qui a prêté le
serment d’Hippocrate, puisse l’aider à opérer cette mutilation, de la même
manière qu’on n’est pas autorisé à casser le bras d’un masochiste qui demande
qu’on lui casse le bras.
Il se pourrait que le terme mutilation soit abusif. Les
partisans du « transgenre » considèrent que l’opération permettant de changer
de sexe n’est pas une mutilation, mais un pas fait pour faire coïncider
l’identité biologique et l’identité psychique. Quand le pape organisait des
rafles de jeunes garçons pour les castrer afin d’en faire des chanteurs à la voix
très aiguë, il mutilait ces garçons et pour leur « bien », puisque la vie d’un
castrat à la cour pontificale devait être malgré tout « meilleure » que la vie
dans un milieu pauvre jusqu’au siècle dernier ! L’excision par ablation des
grandes lèvres permet sûrement l’intégration dans la communauté et c’est bien
pourquoi ce sont les mères excisées qui insistent souvent pour que leurs filles
le soient à leur tour, et donc on pourrait considérer que c’est un « bien »,
thèse soutenue par certains relativistes culturels. On le voit, la notion de ce
qui est un bien est un peu trop élastique pour donner des critères moraux
sérieux. Il n’est pas besoin d’avoir lu la Critique
de la raison pratique et les Fondements
de la métaphysique des mœurs de Kant pour s’en convaincre.
Un changement de sexe est bien objectivement une mutilation,
puisqu’on perd les organes liés au plaisir et à la reproduction (le cas échéant)
ne gagnant pas les organes de l’autre sexe, mais seulement des faux semblants,
des piteuses caricatures de pénis et de clitoris. Les vaginoplasties ne créent
pas des vagins capables de se lubrifier eux-mêmes et les phalloplasties ne
produisent que des bouts de chair pendante, sauf à leur coller des prothèses
mécaniques — pour les prothèses de sexe, il y avait déjà l’antique godemichet
modernisé en vibromasseur, lequel, hélas, n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.
De quelque manière qu’on pose le problème, les opérations de
« transsexuation » sont bien des mutilations sexuelles. On peut dire que ce
sont des mutilations sexuelles volontaires, mais cela ne change rien à la
caractérisation et il n’y a aucune raison que la société apporte son concours à
ces pratiques, sous quelque forme que ce soit.
Bricolage : le corps en pièces détachées
La vision du corps qui ressort de cette plongée dans le
monde de la « réassignation » est celle d’un montage d’organes qu’on peut découper
et remonter à volonté. Le moi-corps, ce corps subjectif qui est
l’investissement même du réel par le sujet, investissement dans lequel le sujet
lui-même se constitue, est transformé en un simple montage d’organes. Dans l’Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari
faisaient l’éloge de la schizophrénie comme véritable critique en acte du
capitalisme. Cette proposition découlait d’une vision du réel comme composé de
« machines désirantes » : un corps n’est rien d’autre qu’un branchement de
machines désirantes. On peut certes critiquer les thèses de Deleuze et Guattari
et leurs conséquences, mais les concepts qu’ils produisent disent quelque chose
de l’idéologie du temps présent.
Le transgenre met bien le corps en pièces détachables et
interchangeables. Prendre de la peau du bras pour fabriquer un bout de
pseudo-pénis, prendre l a peau du
pénis et des testicules pour fabriquer des organes féminins, voilà la routine
des opérations de réattribution de sexe. Voyons le détail. La vaginoplastie
n’est pas a priori une opération liée
à une réattribution de sexe. Elle peut être une simple opération de
régénération du vagin, du même type que les autres opérations de chirurgie
esthétique, notamment à la suite d’un accouchement. Mais la vaginoplastie de
changement de sexe est d’une autre nature. Comment les choses se passent-elles ?
Ça commence par une thérapie hormonale qui est une sorte d’anti-puberté et développe
chez le futur réattribué des caractères féminins (diminution de la pilosité,
croissance des seins), et avec une forte baisse des capacités érectiles. La
thérapie hormonale est arrêtée deux à trois semaines avant l’intervention. La
personne qui va subir cette intervention est hospitalisée la veille de
l’opération. Au cours de cette intervention chirurgicale, qui dure de deux à
quatre heures sous anesthésie générale, le chirurgien retire les deux
testicules et le contenu du pénis, puis crée un vagin en utilisant la peau du
pénis soudée à l’extrémité et retournée vers l’intérieur (et une greffe de peau
en plus si nécessaire). Le clitoris est créé à partir du sommet du gland. Le
prépuce est utilisé pour créer les petites lèvres, les parties extérieures du
scrotum pour créer les grandes lèvres. Élémentaire, non ?
Comment se passe la phalloplastie ? Comme pour la
vaginoplastie, on commence par une cure d’hormones (mâles cette fois) qui
change la voix et fait pousser les poils ; on peut compléter par une mastectomie.
Ensuite on passe à l’hystérectomie (ablation de l’utérus). Grâce à de la peau
prélevée sur le bras, le ventre ou une cuisse, on fabrique un pénis qu’on
greffe en raccordant l’urètre pour permettre au réattribué sexuellement
d’uriner debout. Le raccordement se fait en utilisant les petites lèvres. On
peut également implanter des prothèses de testicules qui seront bien pratiques
pour y loger la pompe actionnant le pénis érectile artificiel. On réfléchit
aussi sur la greffe du pénis, bien que cette opération soit encore très rare aujourd’hui
(c’est-à-dire au moment où ces lignes sont écrites) et réservée uniquement aux
hommes émasculés par accident — un soldat américain blessé en Afghanistan s’est
vu ainsi greffer pénis et scrotum — mais on n’a encore jamais greffé de pénis
sur une femme.
Inutile d’entrer dans les détails. Et laissons de côté les
éventuelles complications chirurgicales, les souffrances endurées par le
candidat à la réassignation de sexe, la débauche de chirurgie et les moyens
hospitaliers qui sont consacrés à ces opérations, fort utiles au business de la
santé. On a bien affaire à du bricolage où les diverses parties du corps sont
coupées, réassemblées différemment. Il faut s’interroger sur la signification
de la mise du corps en pièces détachées. On pourrait commencer par admettre que
la dysphorie de genre exprime un rapport pervers ou psychotique avec son propre
corps — la dislocation du rapport au corps est souvent caractéristique de la
schizophrénie. Se sentir femme dans un corps d’homme ou homme dans un corps de
femme, c’est bien un déni du réel. Le corps propre, c’est le sujet lui-même et
cette idée que le corps est un ensemble de pièces ajustables en fonction des
désirs du sujet est proprement folle. Or c’est cette idée que véhiculent les
théoriciens du transgenre : je pourrais choisir mon corps en quelque sorte
comme je choisis l’ameublement de mon salon.
On sait bien que la réparation des corps mutilés par des
accidents ou par des brûlures nécessite toutes sortes d’opérations complexes
qui ressortissent elles aussi à ce « bricolage » et à ces montages de morceaux
du corps. La chirurgie réparatrice après les cancers du sein ou après les
excisions est évidemment incontestablement un progrès considérable et on ne
peut plus légitime, puisqu’il s’agit simplement de rétablir dans son intégrité
un corps ravagé par la maladie ou par la cruauté des coutumes barbares. Mais
dans le cas de la réassignation, il s’agit de bien autre chose : non pas
rétablir, mais transformer le corps selon les desiderata du sujet.
La possibilité de développer ce bricolage du corps humain
renvoie à une vision de l’homme et à un projet. Cette vision de l’homme est
celle d’un individu qui n’a plus à proprement parler de « soi », qui ne forme
plus une unité, un individu au sens strict, mais bien un « dividu », divisible
selon les besoins et que l’on peut réagencer à volonté. Cette vision mécaniste
est tout simplement la projection sur l’être humain du modèle du robot. Dans sa
préface à la Philosophie dans le boudoir,
Yvon Belaval a bien montré comment le récit sadien transforme les rapports
sexuels en montages de machines embrayant les unes dans les autres. L’homme
coupé en morceaux ressortit à cet embrayage de machines.
C’est encore cette vision du corps éclaté qui est à la base
de la schizophrénie telle qu’elle s’exprime chez Antonin Arthaud. Dans Pour en finir avec le
jugement de Dieu, Artaud en donne une explication : « L’homme est
malade parce qu’il est mal construit. » Et s’il est mal construit, c’est parce
qu’il a des organes ! Or « il n’y a rien de plus inutile qu’un organe. Lorsque
vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l’aurez délivré de tous
ses automatismes et rendu à sa véritable liberté. » Deleuze et Guattari
soutiennent[5] que cet
« informe » qui entoure la conscience et la menace éventuellement, ce « corps
sans organe », c’est un « plan » de la réalité du corps, une strate du corps
qui s’oppose à l’organisme, c’est-à-dire au corps composé d’organes structurés,
à ces rapports de force dont parle Nietzsche. L’organisme est en quelque sorte
l’exploitation du corps ligoté par la hiérarchisation ou la centralisation de
ses différentes parties, et par conséquent assujetti. La rébellion contre cette
organisation, c’est cela qu’on trouve chez Arthaud. Cette position s’oppose à
l’idée du « moi-corps » que l’on a trouvée dans la phénoménologie. Le Corps
sans Objet de nos deux auteurs n’est pas une conscience engagée dans le
monde. Il n’y a plus de place pour un « Moi ». Pas plus qu’il n’y a de place
pour l’Un. C’est une pure multitude qui se présente maintenant à nous.
Voilà quelle vision émerge à l’arrière-plan de l’idéologie « trans ».
Voyons maintenant pourquoi cette vision qui ne peut a priori que renvoyer aux destins individuels devient aujourd’hui une
question sociale ? Pourquoi ce qui restait très marginal devient-il si
important qu’on entreprend de dispenser des « formations » aux enfants des
écoles pour les inciter à ne pas tomber dans la « transphobie » ? En vérité, la
conception du corps et des rapports à la sexualité qui constituent
l’arrière-plan de la très étonnante « transmanie » contemporaine renvoie
directement au développement actuel du mode de production capitaliste. Si le
corps peut être modifié à volonté, ses organes changés ou transformés, s’ouvre
une nouvelle manière de penser l’homme et un nouveau terrain d’expérimentation.
La fabrique de l’humain, qui commence à tourner à plein régime avec la PMA,
pourrait trouver dans la fabrique du sexe un complément utile. On produit de
plus en plus souvent des enfants dont le sexe (en attendant plus) a été choisi
par les parents, il va de soi qu’on doit pouvoir ensuite modifier ce sexe —
puisque celui-ci était déjà le résultat d’un choix. Un deuxième aspect s’impose
également : laisser la loterie de la méiose décider de qui je suis
biologiquement est une intolérable atteinte à ma liberté de sujet roi. Je n’ai
aucune raison d’accepter que des processus aussi aléatoires que les processus
vivants me déterminent ! Il faut là aussi laisser toute sa place à la nouvelle
ingénierie du vivant, dont cette mise en pièces du corps humain est la
condition. Si la réification — concept de Lukacs repris par la théorie critique
— caractérise le mode de production capitaliste, aujourd’hui, cette
transformation du corps humain en assemblage de pièces que l’on peut changer à
volonté constitue une des pointes avancées de cette réification.
L’hermaphrodite comme idéal social
John Money (1921-2006) est le grand maître du transgenre à
notre époque. Psychologue et sexologue renommé, enseignant, il soutenait l’idée
que le genre est une construction sociale. Bien que la réputation de Money ne
soit pas toujours fameuse dans les gender
studies, en raison de son opération ratée sur David Raimer, il reste une
référence incontournable puisque c’est lui qui introduit les concepts de « rôle
de genre », de paraphilie, et autres semblables qui sont devenus d’un usage
courant. Les hermaphrodites constituent son premier objet d’étude et c’est à
partir de cette fascination pour les hermaphrodites que Money en est venu à la
conclusion que le sexe était une construction sociale. Si on opère
convenablement un bébé mâle on peut le transformer en fille, et c’est
précisément ce que Money a tenté en prenant pour cobaye un enfant mâle né avec
une malformation du pénis. Comme il est nettement plus facile de couper un
morceau de chair des organes masculins que de greffer des organes sexuels
féminins, l’expérience de Money s’est faite dans une seule direction. Et s’est
terminée par un échec lamentable qui aurait dû classer ce monsieur dans une
catégorie voisine de celle des soi-disant médecins des camps nazis.
La fascination pour les hermaphrodites est ancienne. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
comporte de très nombreuses planches qui leur sont consacrées. Dans Le Rêve de d’Alembert, Diderot fait dire
à Mlle de Lespinasse « L’homme n’est peut-être que le monstre de la
femme, ou la femme le monstre de l’homme ». Considérant que les organes
génitaux de l’homme et de la femme sont simplement inversés par retournement à
l’intérieur ou extirpation à l’extérieur, ils seraient bien ainsi les monstres
l’un de l’autre. Il y aurait beaucoup à dire sur l’utilisation du monstre dans
la pensée évolutionniste de Diderot, notamment telle qu’elle est exposée dans
les explications que Bordeu donne à Mlle de Lespinasse. Toute
évolution et transformation du genre est déjà monstrueuse. C’est ce qu’Aristote
indiquait déjà : « D’ailleurs celui qui ne ressemble pas aux parents est
déjà, à certains égards, un monstre : car dans ce cas, la nature
s’est, dans une certaine mesure, écartée du type générique. Le
tout premier écart est dans la naissance d’une femelle au lieu d’un mâle. » (De la génération des animaux) La
différence des sexes est en effet « monstrueuse » pour le petit garçon qui
découvre que la petite fille, à la place du pénis, ne montre qu’une mystérieuse
fente, comme cet appendice masculin paraît monstrueux à la petite fille. Elle
est monstrueuse parce qu’incompréhensible. Pourquoi il (ou elle) n’est-il (ou
elle) pas semblable à moi ? La question freudienne de la castration et du
rapport au phallus se joue là-dedans.
À partir de l’analyse du petit Hans, Freud avance le
complexe de castration comme explication infantile de la différence des sexes :
la fille est cet être à qui manque le pénis et le garçon se trouve dans la
situation angoissante où domine la peur de se retrouver comme la petite fille,
privé de pénis. C’est du moins l’explication que donne Freud dans ses Trois essais et qu’il reprend dans son Introduction à la psychanalyse : « La
curiosité sexuelle de l’enfant commence de bonne heure, parfois avant la troisième
année. Elle n’a pas pour point de départ les différences qui séparent les
sexes, ces différences n’existant pas pour les enfants, lesquels (les garçons
notamment) attribuent aux deux sexes les mêmes organes génitaux, ceux du sexe
masculin. Lorsqu’un garçon découvre chez sa sœur ou chez une camarade de jeux l’existence
du vagin, il commence par nier le témoignage de ses sens, car il ne peut pas se
figurer qu’un être humain soit dépourvu d’un organe auquel il attribue une si
grande valeur. Plus tard, il recule, effrayé devant la possibilité qui se
révèle à lui et il commence à éprouver l’action de certaines menaces qui lui
ont été adressées antérieurement à l’occasion de l’excessive attention qu’il
accordait à son petit membre. Il tombe sous la domination de ce que nous
appelons le “complexe de castration”, dont la forme influe sur son caractère,
lorsqu’il reste bien portant, sur sa névrose, lorsqu’il tombe malade, sur ses
résistances, lorsqu’il subit un traitement analytique. En ce qui concerne la
petite fille, nous savons qu’elle considère comme un signe de son infériorité l’absence
d’un pénis long et visible, qu’elle envie le garçon parce qu’il possède cet
organe, que de cette envie naît chez elle le désir d’être un homme et que ce
désir se trouve plus tard impliqué dans la névrose provoquée par les échecs qu’elle
a éprouvés dans l’accomplissement de sa mission de femme. Le clitoris joue d’ailleurs
chez la toute petite fille le rôle de pénis, il est le siège d’une excitabilité
particulière, l’organe qui procure la satisfaction auto-érotique. La
transformation de la petite fille en femme est caractérisée principalement par
le fait que cette sensibilité se déplace en temps voulu et totalement du
clitoris à l’entrée du vagin. Dans les cas d’anesthésie dite sexuelle des
femmes, le clitoris conserve intacte sa sensibilité. » Laissons de côté les
jugements implicites de Freud qui témoignent du fait qu’on ne parvient jamais à
sauter par-dessus sa propre tête — la « mission de la femme » et le déplacement
normal de la sensibilité du clitoris vers le vagin… Il reste une description
des angoisses de la petite enfance dont l’évidence est assez claire et même
plutôt banale.
Dans la mesure même où l’instinct chez l’homme laisse la
place à l’éducation (et parfois même au dressage), la question du destin de
tout individu humain est d’abord dans ce rapport au sexe, s’identifier au sien
propre et accepter la différence de l’autre. C’est précisément ce que refuse
l’idéologie LGBT+etc. et la théorie du genre flottant qui fait de
l’hermaphrodite son emblème. Donnons-en deux exemples.
Les hommes à apparence
féminine (le politiquement correct interdit qu’on use du terme shemale considéré par les « trans »
comme insultant ou diffamatoire) sont un genre particulier d’hermaphrodites
produits artificiellement et classés parmi les « transgenres », à tort,
puisqu’ils n’ont précisément pas changé réellement génitalement. Ce sont typiquement
les personnages de certains films de Pedro Almodovar (Tout sur ma mère, par exemple), des hommes ayant acquis une
apparence extérieure de femme (visage remodelé, seins, hanches et fesses, absence
de pilosité), mais avec des organes sexuels masculins fonctionnant normalement.
Les textes qui se rapportent à ces individus utilisent généralement le féminin
pour les désigner alors que c’est évidemment le masculin qui les caractérise le
mieux : ils ont des érections et des éjaculations comme n’importe quel homme.
Ils occupent une place très particulière à la fois dans le milieu de la
prostitution et dans le cinéma pornographique. S’ils ont cette place, il faut
bien qu’il y ait des amateurs ou des clients ! Et ce qui se met en scène ici,
c’est l’ambiguïté fondamentale de la sexualité dont ces intrigants personnages sont
les opérateurs privilégiés. Un homme qui a des rapports sexuels avec un/une « shemale » y joue aussi bien le rôle d’un
homme ayant des rapports avec une prostituée qu’il ne peut que sodomiser ou en
obtenir une fellation que le rôle d’un homosexuel « passif » puisqu’il peut
être sodomisé ou faire une fellation à son/sa partenaire « shemale ».
Les femmes presque devenues des hommes représentent en
quelque sorte l’inverse du cas précédent. Il s’agit de femmes qui ont modifié
leur apparence extérieure pour devenir semblables à des hommes sans pour autant
avoir effectué l’opération de réassignation sexuelle — à ne pas confondre avec
l’hirsutisme, maladie qui affecte certaines femmes en leur donnant une pilosité
bien gênante qui en fit longtemps des phénomènes de foire. Un cas avait défrayé
la chronique : une femme devenue homme homosexuel était enceinte de son
compagnon et a mis au monde un enfant né, selon l’état civil, de deux hommes !
Là encore on est dans le monde des simulacres, cet homme selon l’état civil
était bien une femme déguisée en homme, rôle de comédie, comme celui de l’homme
déguisé en femme dans Tootsie. La
comédie de Blake Edwards, Victor Victoria,
mettant en scène une femme qui se déguise en homme qui se travestit exhibe avec
brio ce jeu de miroirs dans lequel nous aimons à nous complaire parce qu’il
fait jouer des ressorts inconscients communs à toute l’humanité.
Dans ces deux cas d’hermaphrodites dont nous venons de
parler, il ne s’agit pas de véritables hermaphrodites, au sens biologique,
puisqu’ils ne peuvent pas jouer alternativement les deux rôles sexuels, comme
cela se produit assez souvent chez les invertébrés. Ils sont seulement des
hermaphrodites au sens de la mythologie grecque, ces hermaphrodites de la
statuaire ou des fresques antiques, représentant le fils ou la fille d’Hermès
et d’Aphrodite unissant la beauté de ses deux parents. L’étrangeté de
l’hermaphrodite et la fascination qu’il exerce tient précisément à ce qu’il met
en cause la différence des sexes, cette différence vécue sans doute par
l’humanité comme une déchirure et une malédiction. Dans le mythe d’Aristophane,
rapporté par Platon dans Le banquet,
l’humanité était composée d’êtres doubles avec quatre bras, quatre jambes et
deux faces. Ces êtres étaient soit masculins, soit féminins, soit d’un genre
aujourd’hui disparu, les androgynes (mot-à-mot hommes-femmes). La complétude de
ces êtres doubles leur conférait de très nombreux pouvoirs si bien que Zeus a
décidé de les diviser en deux et à plongé chacune des moitiés dans la recherche
éperdue de son autre moitié. De cette séparation il n’est resté que les deux
genres masculins et féminins, les androgynes se rattachant pour moitié à l’un
de ces genres et pour moitié à l’autre. Ce mythe pourrait expliquer l’amour
homosexuel (les moitiés mâles qui recherchent leur moitié mâle et les moitiés
femelles qui cherchent leur moitié femelle), mais aussi ce qui pousse les hommes
et les femmes les uns vers les autres, ainsi que la nostalgie de cette
complétude disparue.
Sans aucun doute, il y a en chaque homme l’aspiration à être
une femme qui possède le privilège fantastique de pouvoir enfanter — et c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle la stérilité féminine doit être conjurée de
toutes sortes de manières dans les sociétés archaïques. Toute femme désire
aussi être un homme et les hommes admirent souvent les femmes « qui portent la
culotte ». Au-delà des stéréotypes sociaux imposés dans les sociétés
patriarcales, il y a bien un désir profond d’être interchangeables, mais aussi
un désir de se suffire à soi-même et d’abolir cette incomplétude qui nous
oblige à nous rapporter à l’autre, ne serait-ce que pour avoir des enfants — ce
à quoi notre société s’évertue à donner des solutions avec la PMA et la GPA,
avant d’en finir une fois pour toutes avec le souci de la maternité grâce à l’ectogenèse,
c’est-à-dire l’utérus artificiel qui transformera en réalité la dystopie
d’Aldous Huxley dans Le meilleur des
mondes.
L’exigence « trans » est, au moins en partie, l’exigence que
ce désir soit satisfait avec la complicité active du business médical, qui,
comme tout capital doit sans cesse trouver de nouveaux champs d’investissement
pour que se poursuive l’accumulation du capital. Jusqu’à notre monde, les
sociétés humaines savaient que tous les désirs n’ont pas à être satisfaits et
doivent être sublimés et c’est précisément dans ce processus de sublimation que
s’enracine la construction de la civilisation. Aujourd’hui la technoscience se
propose de donner une satisfaction technoscientifique – illusoire parce que
technoscientifique, purement instrumentale — à tous nos désirs : tu es
femme et veux faire un enfant toute seule ? Pas de problème, on a la PMA. Tu es
homme et veux un enfant sans passer par ce répugnant commerce du rapport sexuel
avec une femme ? On a la solution : la GPA. Vous voulez une fille et pas
un garçon ? On a à notre disposition la FIVETE. Et ainsi de suite, en attendant
les mille et une merveilles que nous promettent les manipulations génétiques.
Tu veux changer de sexe ? Pas de problème, la chirurgie a tout ce qu’il faut à ta
disposition.
Si la fantaisie est la forme première de la sublimation, la
volonté de réaliser les fantasmes, c’est-à-dire le refus de garder le fantasme
à l’état de fantasme, en usant des moyens de la technoscience médicale peut
être caractérisée comme désublimation, une désublimation qui soumet le corps
aux méthodes du principe de rendement et correspond exactement à ce que Marcuse
appelle désublimation répressive. L’hermaphrodite, dès lors qu’il quitte le
royaume de la fantaisie pour entrer dans la réalité sociale prend toute sa
place dans ce jeu de simulacres qu’est la société du spectacle. Mais le
spectacle dissimule en les montrant les rapports entre les individus tels
qu’ils sont modelés par le capital. L’hermaphrodite devient l’archétype de
l’homme interchangeable, tour à tour homme et femme, consommateur sans qualité
et producteur malléable, humain sans qualité à quoi les humains doivent tous
êtres réduits quand le capital a écrasé toutes les vieilles formes sociales, éliminé
toutes les différences sous la loi de l’équivalent général, le grand fétiche
devant qui tous sont égaux, l’argent.
Le narcissisme
Le désir de changer de sexe est très souvent le désir de
correspondre à l’image que l’on se fait de soi-même. De ce point de vue, la
montée statistique du transgenre n’est qu’un des aspects de ce que Christopher
Lasch nommait « la culture du narcissisme ». Freud introduit la question du
narcissisme dans un texte de 1914. Il commence par reprendre la définition de
Näcke : le narcissisme désigne « le comportement par lequel un individu
traite son propre corps de façon semblable à celle dont on traite d’ordinaire
le corps d’un objet sexuel : il le contemple donc en y prenant un plaisir
sexuel, le caresse, le cajole, jusqu’à ce qu’il parvienne par ces pratiques à la
satisfaction complète ». La pratique psychanalytique montre que l’on trouve des
traits narcissiques dans l’homosexualité (ce qui semble assez évident) et dans
de nombreuses névroses. Si au premier abord on peut qualifier le narcissisme de
perversion, Freud, cependant, en arrive très rapidement à l’idée qu’il y a un
narcissisme normal, celui qui défend l’égoïsme de l’individu et que le
psychanalyste rencontre dans la résistance que le patient oppose à l’influence
que le médecin cherche à lui imposer. À partir de ces considérations, Freud
développe une interprétation de la schizophrénie qui le conduit non à supprimer,
mais à réviser la séparation entre les pulsions libidinales et les pulsions du
moi, qui constitue l’un des traits caractéristiques de la première topique. Il
montre que : « Les premières satisfactions sexuelles auto-érotiques sont
vécues en conjonction avec l’exercice de fonctions vitales qui servent à la
conservation de l’individu. Les pulsions sexuelles s’étayent d’abord sur la
satisfaction des pulsions du moi, dont elles ne se rendent indépendantes que
plus tard ; mais cet étayage continue à se révéler dans le fait que les
personnes qui ont affaire avec l’alimentation, les soins, la protection de l’enfant
deviennent les premiers objets sexuels c’est en premier lieu la mère ou son
substitut. »
Mais cette observation semble contredite par la clinique
d’un certain nombre de perversions. « Nous avons trouvé avec une particulière
évidence chez des personnes dont le développement libidinal est perturbé, comme
les pervers et les homosexuels, qu’ils ne choisissent pas leur objet d’amour
ultérieur sur le modèle de la mère, mais bien sur celui de leur propre
personne. De toute évidence, ils se cherchent eux-mêmes comme objet d’amour, en
présentant le type de choix d’objet qu’on peut nommer narcissique. C’est dans
cette observation qu’il faut trouver le plus puissant motif qui nous contraint
à l’hypothèse du narcissisme. »
Après d’intéressants développements sur la libido féminine, que
nous laisserons de côté, Freud, résumant la distinction entre libido d’objet
par étayage et libido d’objet narcissique, en arrive à la conclusion
suivante : « On aime : 1) Selon le type narcissique a) Ce que l’on
est soi-même ; b) Ce que l’on a été soi-même ; c) Ce que l’on voudrait être
soi-même ; d) La personne qui a été une partie du propre soi. 2) Selon le type
par étayage : a) La femme qui nourrit ; b) L’homme qui protège ; et les
lignées de personnes substitutives qui en partent. Le cas c) du premier type ne
pourra être justifié que par des développements qu’on trouvera plus loin. Il
restera, dans un autre contexte, à apprécier l’importance du choix d’objet
narcissique pour l’homosexualité masculine. » Ajoutons que le cas c) du premier
cas permet aussi de donner un début d’explication de la dysphorie de genre. On
aime par narcissisme ce que l’on voudrait être soi-même : Freud y voit une
explication de l’homosexualité masculine, mais on peut y voir aussi la clé de
la compréhension du « trouble dans le genre ». Une femme qui aime en l’homme ce
qu’elle voudrait être elle-même, voudrait donc s’aimer (narcissiquement) en
tant qu’en homme et c’est précisément ce narcissisme qui lui fait rejeter son
propre corps et vouloir avoir le corps d’un homme, de pouvoir exhiber les
atours virils et uriner debout !
Ce dernier point est si important qu’on le voit revenir dans
presque toutes les études sur les opérations de réassignation de sexe : le
plus important dans la greffe d’un pseudo-pénis n’est pas tant d’avoir des
érections qui ne pourront pas se terminer par une décharge, mais bien de
pouvoir enfin uriner debout. Un certain féminisme fait d’ailleurs de la manière
d’uriner une des conditions de l’égalité homme/femme. Ainsi en Suède, en 2013,
un député aurait-il défendu un projet de loi visant à obliger les hommes à
uriner assis en vue « d’améliorer l’hygiène, renforcer l’égalité homme-femme et
lutter contre le cancer de la prostate. » C’était une information un peu
exagérée : il ne s’agissait que d’un projet de résolution déposé dans un
comté par le « parti de gauche » local et visant à aménager les toilettes de
telle sorte que les hommes puissent plus facilement pisser assis… Mais l’affaire
est hautement significative, non seulement de l’angoisse de castration qui
saisit le société « hétéronormée », comme on dirait dans Libération, mais aussi et surtout des préoccupations « de gauche »
pour en finir avec les conceptions « binaires » de la vie ordinaire.
Notons qu’il existe des urinoirs féminins, jetables ou réutilisables permettant
aux femmes d’urine debout sans changer de sexe (en vente sur un grand site de
vente en ligne). Par ailleurs, les Égyptiens anciens, selon Hérodote, urinaient
assis, comme les Indiens (paraît-il) ou les Arabes. Bref, il n’y a pas de dogme
médical ou scientifique sur ce sujet. Ce sont des images qui sont en cause. Or,
et cela nous ramène à la question transgenre, il s’agit bien dans ce cas des
images, l’image du « mec » et du désir d’aimer en soi cette image. Narcisse
aime son image. Et si l’on peut étendre le narcissisme, comme le fait Freud, à
l’amour de l’image de ce que l’on voudrait être, l’essentiel dans les
opérations de réassignation de sexe n’est pas le sexe, mais l’image du sexe.
On le sait par d’autres observations. Les garçons qui
voudraient être des filles sont d’abord des garçons qui voudraient qu’on les
trouve jolis comme des filles, qui voudraient s’habiller en filles autrement
que par jeu (toujours révélateur de l’inconscient). Dans la « société du
spectacle », où le spectacle se substitue à la vie, il est assez naturel qu’on
en arrive là et que la technoscience comme toujours vienne au secours du spectacle.
Le transgenre n’est pas la forme unique de la « culture du narcissisme » qui
domine entièrement nos sociétés, comme l’a très bien montré Christopher Lasch —
il suffit de penser au « selfie » et
à la manie touristique consistant à se photographier soi-même devant un site
touristique pour bien montrer que l’important n’est le site, mais le « moi »
tout-puissant. Mais la forme transgenre du narcissisme s’accorde peut-être
beaucoup mieux à d’autres exigences du « capitalisme du troisième âge », comme l’interchangeabilité
des individus, le culte de la technique et la mise à raison du corps devenu
viande, matière à tailler, à sculpter, à transformer.
Hybris de la médecine
Le changement de sexe a longtemps été considéré comme
l’impossible par excellence. On disait du Parlement britannique qu’il pouvait
tout faire sauf changer un homme en femme ! Même le tout-puissant parlement
britannique se heurtait à cette limite. En dépassant cette limite, l’homme
accède donc enfin à la véritable toute-puissance. Il est capable de se faire
lui-même, il est causa sui, le petit
nom de Dieu dans la scolastique. Mais il le fait par les moyens de la
technique : chirurgie, biochimie, etc. C’est bien en cela que le
transgenre est une branche du transhumanisme. Changer de sexe, c’est tout
simplement transgresser les lois qui assignent l’individu humain à une
existence déterminée et qui délimite drastiquement le cercle où peut s’exercer
la liberté.
Car la médecine joue un rôle central dans le projet
transhumaniste ou post-humaniste — termes dont nous avons dit qu’ils sont à peu
près équivalents sinon, peut-être, que le « trans » prépare le « post ». Pour
que l’homme cesse d’être homme, il faut l’augmenter. Et en premier lieu vaincre
la mort : Laurent Alexandre, médecin urologue, homme d’affaires avisé — il
a fondé et bien revendu le site Doctissimo
— fait l’annonce à qui veut l’entendre de la « mort de la mort ». Il est un des
apôtres du transhumanisme et un grand adorateur de la soi-disant « intelligence
artificielle » (IA). C’est le même Laurent Alexandre qui annonce dans le Figaro (13/06/2017) que la dystopie du
film Bienvenue à Gattaca va devenir
la norme : « La sélection embryonnaire sous une forme un peu plus
sophistiquée que Bienvenue à Gattaca deviendra
la norme. Ce n’est pas mon souhait personnel, mais un pronostic. » Union de
l’homme et de l’IA, l’homme du futur pourra ainsi gagner cette course à
l’intelligence. Laurent Alexandre assène : « Selon un sondage réalisé en
2016, 50 % des jeunes chinois éduqués souhaitent pouvoir augmenter le QI
de leur futur bébé… Un pourcentage d’adhésion qui grimpera en flèche… dès que
les parents se rendront compte que les enfants de leurs voisins ont tous 50 points
de QI de plus que les leurs… » Si on lui fait remarquer que l’homme est un être
sensible qu’on ne saurait réduire à son cerveau, l’éminent savant en tout coupe
net à l’objection : « L’homme se réduit à son cerveau. Nous sommes notre
cerveau. La vie intérieure est une production de notre cerveau. » Si l’homme se
réduit à son cerveau, le corps n’est donc bien que de la vile matière à
disposition de la « vie intérieure » produite par le cerveau.
L’hybris médicale trouve dans les prouesses des bricoleurs
de la réassignation sexuelle un large champ d’expression. Ce n’est sans doute
pas par hasard que la science maîtresse de nos jours n’est plus la physique,
mais la biologie, car c’est dans la biologie qu’on peut espérer trouver les
moyens d’en finir pour de bon avec l’homme, cette si imparfaite créature du
hasard. Quand Laurent Alexandre cite Bienvenue
à Gattaca, il fait mine d’oublier que le premier modèle de cette biologie
devenue folle date des années 30 et c’est Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Or c’est bien vers cela que
veulent aller les scientifiques les plus fous et surtout leurs commanditaires
ivres de puissance. Grâce à la médecine scientifique moderne, on va pouvoir
décharger l’humanité du fardeau de la procréation : en attendant les
hommes immortels qui iront coloniser Mars, l’utérus artificiel est annoncé. L’ectogenèse
est évidemment conçue pour les meilleures intentions du monde, par exemple
faciliter la survie des fœtus humains ultra-prématurés. Des essais concluants
ont été menés sur des agneaux et on espère pour les années 2020 des essais
concluants sur l’humain. On annonce d’un autre côté que les opérations de
réassignation sexuelle pourraient s’améliorer au point de donner une véritable
sensibilité sexuelle aux organes greffés. Bref on pourrait définitivement
s’affranchir de la division de l’humanité en sexes mâle et femelle puisque la
question de la reproduction, de son côté, ne se poserait plus.
La médecine nous promet un monde merveilleux. Ce monde
merveilleux est-il possible ? Sans doute pas : les lubies d’Alexandre
Laurent lui font gagner beaucoup d’argent, mais la durée maximale de la vie ne
bouge pas et l’espérance de vie en bonne santé a une fâcheuse tendance à
baisser. Il en sera certainement de même concernant les utopies sexuelles et
transgenrées. Mais en attendant il y a de l’argent à faire et une idéologie
envahissante promue par une propagande totalitaire d’autant plus efficace
qu’elle se fait au nom de la bienveillance et au moyen de techniques
prétendument neutres. Mais si nous supposons que ce « monde merveilleux » promu
par la médecine délirante puisse un jour advenir, alors il y a de bonnes
raisons qu’il soit un véritable enfer. D’un certain point de vue, la question
de la survie de l’humanité ne se poserait plus car il n’y aurait tout
simplement plus d’humanité.
La subversion au service de la tradition patriarcale.
Les partisans du transgenre cherchent souvent à banaliser
leur position en trouvant dans les sociétés traditionnelles de telles formes de
« subversion » dans la réassignation des genres. Ainsi l’étude des « vierges
jurées » d’Albanie fournit-elle un exemple fort instructif. En Albanie et,
semble-t-il, plus généralement dans les Balkans, il existait tout un rituel
permettant à une femme de devenir un homme. Si, par exemple, un homme n’avait
pas d’enfant mâle, il pouvait faire de sa fille son héritière à l’expresse
condition qu’elle jure de devenir un homme et donc de n’avoir aucun rapport
sexuel avec un homme. Elle était alors considérée comme un homme et bénéficiait
de tous les privilèges attachés au sexe masculin[6].
Il est d’autres exemples connus et qui, comme tous ces cas particuliers,
permettent de nourrir le relativisme. Ainsi chez certains peuples d’Afrique
(Nuers du Soudan) une femme stérile peut être officiellement reconnue comme un
homme et épouser une femme. Ce n’est pas un couple lesbien qui fournirait
le modèle du mariage pour tous, mais, aux yeux de cette société un couple tout
à fait normal, même si l’épouse ne peut tomber enceinte que d’un homme qui sera
utilisé seulement comme reproducteur, l’enfant qui naîtra prenant le nom de « l’époux »
fictif. Loin d’infirmer la règle, cet exemple ne fait que la confirmer.
Sous une forme romanesque, ce thème est au centre du roman
de Tahar Ben Jelloun, L’enfant de sable.
Un homme qui veut à tout prix avoir un fils nomme sa huitième fille Ahmed et
l’élève comme un garçon avec tous les privilèges d’un garçon. Ahmed va assumer
l’imposture de son père, épouser une fille délaissée et commencer sa plongée
aux enfers. Il est intéressant de noter que les spécialistes des études
transgenres considèrent de telles pratiques comme subversives alors même
qu’elles ne sont qu’un moyen boiteux pour pallier les inconvénients d’une
société patriarcale stricte. Comme cela arrive souvent, la subversion déchaînée
finit par ressembler comme deux gouttes d’eau à la tradition la plus
réactionnaire. Le féminisme égalitaire, c’est-à-dire celui qui se tient sur le
ferme principe de l’égalité des droits entre hommes et femmes est aujourd’hui
submergé par un « pseudo féminisme » partisan de l’inégalité, le féminisme pro-burka,
le féminisme pro-burkini, le féminisme pro-polygamie et aussi ce féminisme
pro-patriarcat, sous couvert évidemment de valoriser la situation des femmes
par rapport aux hommes et dénoncer les stéréotypes « genrés ».
La haine du sexe
On repérera assez facilement dans toutes ces manifestations
une haine inconsciente du sexe, c’est-à-dire du plaisir sexuel qui se conclut
par l’orgasme dont Wilhelm Reich a bien montré la fonction essentielle. Chasser
le mot sexe au profit du très neutre terme de genre, c’est tout un programme.
Le genre, c’est la grammaire alors que le sexe ça sent le sperme et la cyprine,
la sueur des corps qui s’enlacent, bref, la vie. Par définition, le sexe est
binaire. Il faut toujours un organe dans un autre, même dans la masturbation,
il faut la chose dans la main ou la main dans la chose ! Refuser la binarité du
sexe, c’est en vérité refuser le plaisir sexuel, renoncer à l’orgasme. Reich,
réveille-toi, ils sont devenus fous !
Dans la logique trans, il y a d’abord le dégoût de son
propre sexe. Je me sens femme dans un corps d’homme, cela veut dire : je
n’aime pas ce corps d’homme ! Et inversement. Mais si je deviens femme, comment
vais-je pouvoir maintenant aimer ces corps d’homme ? D’où cette bizarrerie très
fréquente : les transgenres deviennent homosexuels ! Je veux devenir femme
pour mener une vie de lesbienne. On connait aussi des couples de lesbiennes qui
se brisent quand l’une des deux passe à la réassignation de sexe. De même les
hommes devenus « femmes » deviennent lesbiens (ou lesbiennes). Ce qui n’empêche
pas, si le changement de sexe n’a pas été mené à son terme, que ces couples
homosexuels aient des enfants, des enfants issus de deux hommes ou de deux
femmes selon l’état civil, mais issus en réalité, comme tous les enfants, de
gamètes mâles et de gamètes femelles. On est encore dans le simulacre.
Les psychologues parlent de troubles de l’identité sexuelle.
C’est mettre un mot sur ce qu’on comprend mal. Ce trouble de l’identité
sexuelle renvoie fondamentalement à l’incapacité à assumer franchement et sans
détour son propre désir. Comment ne pas y voir l’ancestrale hantise du sexe ?
Freud avait dit, dans une lettre à Jones (1914) : « Celui qui promettra à
l’humanité de la délivrer de l’embarrassante sujétion sexuelle, quelque sottise
qu’il choisisse de dire, sera considéré comme un héros. » Nous en sommes
là : il s’agit bien de promettre à l’humanité qu’on va la débarrasser de
la « sujétion sexuelle » puisque nous ne serons plus liés à un sexe. Ce qui est
très ennuyeux c’est qu’on soit encore obligé, dans la réassignation telle
qu’elle se fait aujourd’hui, de choisir entre mâle et femelle. Pourquoi ne
pourrait-on pas choisir d’être « neutre » ou encore d’un sexe encore inconnu et
à inventer qui ne serait ni mâle, ni femelle, ni neutre ? Ce délire est
maintenant chose courante et montre que la lutte contre la conception « binaire »
est en vérité aussi une lutte contre la logique, qui, comme chacun le sait
depuis les premiers délires post-soixante-huitards, est sans doute d’essence « fasciste ».
Se prendre pour Dieu
Dieu est le seul être qui soit « causa sui » et c’est en ce sens qu’il est absolument libre :
voilà l’enseignement majeur de la théologie chrétienne, codifiée au Moyen âge
et subvertie radicalement par Spinoza. Remplaçons Dieu par la nature et
l’essentiel sera conservé, savoir que l’homme n’est pas absolument libre puisqu’il
n’est pas la cause de sa propre existence ni des lois qui la gouvernent. Thèse
difficilement contestable. Nous n’avons pas décidé d’être ni d’être qui nous
sommes puisque tout cela nous est d’abord donné par la biologie, puis par des
rapports premiers avec des adultes, rapports que nous ne maîtrisons évidemment
pas. « L’homme n’est pas un empire dans un empire, il est une partie de la
nature dont il suit le cours » : il est absolument nécessaire si on ne
veut pas sombrer dans la folie et dans cette forme si classique de la folie
qu’est l’hybris, de tirer toutes les conclusions qui se doivent tirer de cette
thèse spinoziste.
J’ai employé le terme de folie. Je ne fais que suivre ce que
disent de nombreux psychanalystes : « En effet, l’idée qu’on puisse changer de
sexe est une idée folle parce qu’elle se heurte à une impossibilité ; on peut
seulement changer les apparences et l’état civil ; l’intérieur du corps, les
chromosomes restent ce qu’ils sont. Et les transsexuels ne parviennent à “oublier”
le temps de leur vie vécu dans le sexe abhorré qu’au prix d’un déni et d’un
clivage. Le traitement inventé par des médecins depuis le milieu du XXe siècle est une “réponse folle”, une “offre folle” à
la demande folle des transsexuels, même si les faits montrent que c’est un
palliatif qui adoucit la souffrance. » On pourrait ajouter que les
palliatifs pour adoucir la souffrance ne sont pas forcément légitimes :
l’alcool ou les drogues adoucissent bien des souffrances et les médecins ne les
prescrivent pourtant pas.
Quelle est donc la nature de cette folie ? Le choix
de son propre sexe est le premier moyen de se choisir soi-même, exactement
comme le choix du sexe de l’enfant, rendu possible par la FIVETE et l’analyse
du code génétique apparaît comme une manifestation de la puissance parentale
sur l’enfant. On n’a pas assez analysé la perversion qui se manifeste dans la
volonté de choisir le sexe de l’enfant à naître. Il s’agit dans le cas des
parents choisissant le sexe de l’enfant d’être non plus procréateurs, mais
créateurs. L’enfant est leur produit puisqu’ils décident d’une caractéristique
essentielle de ce qu’il sera. Habermas a dit sur ce sujet des choses fort
raisonnables dans L’avenir de la nature
humaine. Qu’on soit capable de transformer la procréation naturelle en une
véritable fabrication de l’humain (avec normes de qualité à l’appui), c’est
bien l’horizon de ces techniques de la PMA qui ont largement dépassé leur champ
initial d’application, à savoir remédier aux problèmes d’infertilité des
couples. Loin d’être une simple avancée de la médecine comme la vaccination ou
les greffes du cœur, il s’agirait d’une transformation ontologique de l’homme.
On pourrait aboutir à une situation où un individu serait dans ce qu’il a de
particulier, de spécifique, dans ce qui fait son individualité, comme le
résultat des calculs parentaux et médicaux. Habermas a montré de manière assez
convaincante qu’une telle situation entraînerait une asymétrie morale fondamentale
entre les individus nés des hasards de la méiose et ceux qui seraient les
produits de la technoscience de la procréation.
La liberté apparente acquise par les parents se paierait
d’une non-liberté des enfants. Dans le cas où c’est le sujet lui-même qui
décide de son propre sexe, il se met lui-même à la place de ses parents
tout-puissants. Je ne leur dois rien, dit-il ! Il affirme ainsi la déliaison de
ce qui enchaîne chaque individu humain, le rapport de filiation. L’opération de
changement de sexe est ainsi l’affirmation démente par laquelle le sujet
devient le parent de lui-même. Il est bien causa
sui comme Dieu est causa sui. La
médecine prolonge ici les transformations qui se sont déjà produites dans le Code
civil. On peut de plus en plus souvent choisir son nom de famille, c’est-à-dire
qu’on choisit ses ascendants. Tout dépend évidemment des systèmes de
nominations variables d’un pays à l’autre. En Espagne, le nom de famille
comporte les noms du père et de la mère (sachant que la filiation est toujours
patrilinéaire et qu’il faut bien à la génération suivante éliminer l’un des
deux noms…) alors qu’en France on hérite généralement du nom du père, sauf
exception. Le problème n’est évidemment pas de savoir s’il faut préférer le
système espagnol au système français, ou même de savoir si on devrait adopter
une filiation matrilinéaire ! Il est que l’individu a le choix : il peut
dire, au fond, « je descends de qui me plaît ». La logique de ce qui se trame
de ce côté-là est de donner à l’individu le droit de s’appeler comme bon lui
semble ; il ne veut s’appeler ni Dupont ni Martin, mais Bonaparte : de
quel droit l’empêcherait-on de se nommer lui-même ainsi ? Dans de nombreux
pays, on permet que les individus choisissent leur sexe (pardon, leur genre)
sur l’état civil et on a introduit un genre neutre (c’est le cas en Allemagne)
avant d’introduire l’un de ces multiples « genres flottants » dont la gender theory s’est fait une spécialité.
Alors que l’état civil enregistre tout simplement l’acte de naissance, c’est-à-dire
un fait qui est typiquement le fait sur lequel l’individu n’a aucune prise, on
donne symboliquement à l’individu le droit de modifier les faits passés ! Je
suis peut-être né Jean Dupont de sexe masculin, qu’à cela ne tienne, je vais
maintenant m’appeler Jeanne Durand de sexe féminin ou Dominique Dubois de sexe
neutre ! On pensait que la réécriture du passé était le propre des systèmes
totalitaires, mais voilà qu’elle devient un droit à l’époque de l’individu-roi !
On pourrait évidemment citer d’autres terribles contraintes qui pèsent sur nous
en raison de notre état civil, comme celles qui sont liées à l’âge. Pour
échapper au départ forcé à la retraite, je pourrais modifier ma date de
naissance en me rajeunissant de dix ans ou au contraire me vieillir pour faire
valoir plus tôt mes droits à la retraite, ou bénéficier des tarifs réduits dans
les chemins de fer ou dans les musées. Et pour couronner le tout, je pourrais
exiger de la médecine qu’elle me façonne un corps adapté à mon nouvel état
civil.
Selon la Genèse, l’homme a été créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu. À l’époque de l’individu, l’homme se prend pour Dieu.
Pour une part, on peut trouver dans ce délire l’aboutissement du projet de la
modernité. Dans la dernière partie du Discours
de la méthode, Descartes annonçait que, grâce à la science nouvelle,
l’homme pourrait devenir « comme maître et possesseur de la nature ». On a
oublié le « comme » (c’est-à-dire qu’on a oublié que l’homme n’était que
l’image et la ressemblance de Dieu) pour penser que nous allions devenir les
maîtres et possesseurs de la nature, sans aucune restriction. Descartes pensait
que la physique non seulement pourrait soulager la peine des hommes grâce à la
construction des machines, mais encore par ses prolongements dans la science
médicale, elle nous garantirait la santé, le plus grand de tous les biens, et
surtout que, l’âme étant étroitement liée au corps, la médecine contribuerait à
nous rendre plus habiles et plus sages. Le bricolage de la réassignation
sexuelle est censé rendre plus heureux les individus mal dans leur peau en
attendant de les rendre plus habiles et plus sages. Il paraît que l’on vient
d’inventer une pilule contre les chagrins d’amour.
Le transgenre est donc bien une des formes des plus
étonnante et bizarre de cette marche en avant au-delà de l’humanité. Le
fantasme de toute-puissance combinée avec la réification complète du corps
humain, un corps qui n’est plus un être vivant, mais de la viande, entre les
mains des bouchers spécialistes de la sculpture sur viande. « Conception
bouchère de l’humanité » disait Legendre. Mais dès que les hommes se prennent
pour Dieu, le religieux revient au grand galop : c’et bien la dépréciation
du corps qui est mise en œuvre dans la fabrication de ces hommes qui ne sont
plus des hommes, mais des simulacres de femmes et de ces femmes qui ne sont
plus des femmes, mais des simulacres d’hommes. Dépréciation au profit de ce
cher moi, de cette âme indépendante du corps et apte à se choisir un corps
comme on choisit un vêtement en magasin. La bonne vieille bigoterie n’est pas
loin.
L’âme séparée du corps, c’est aussi ce que prétendent découvrir
les chercheurs de l’intelligence artificielle, au moment où on se demande s’il
faudra accorder des droits humains aux robots et où l’Arabie Saoudite donne la
citoyenneté saoudienne à l’une de ces machines. Entre les pénis à ressorts ou à
gonflage pneumatique et les âmes des robots, il y a un point commun :
désintrication de la pulsion de mort et désir de retourner à un état
inorganique. Tout cela commence à puer la décomposition de la société soumise à
la loi du capital, à cette société où, comme le disait Marx, « le mort saisit
le vif ».
[1] Giovanni
Pico della Mirandola : De
la dignité de l’homme, Oratio de hominis dignitate, 1486
[2] Jean-Luc
Mélenchon, L’ère du peuple, Fayard,
2014, chapitre 5
[3] Zygmunt
Bauman développe ce concept de « société liquide » dans sa critique de la
post-modernité qui laisse les individus isolés dans la concurrence et encadrés
seulement par un État « garde-chasse ».
[4] En
faisant du consentement la seule règle morale, Ruwen Ogien, Marcella Iacub et
quelques autres, se sont fait les défenseurs de la prostitution et de la GPA.
Michela Marzano, dans Je consens donc je
suis critique cette morale du consentement qui fait fi de la fragilité
humaine. Marcela Iacub défend ardemment l’ectogenèse (cf. infra).
[5] Gilles
Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe.
Capitalisme et Schizophrénie, 1972
[6] Le
relativisme culturel permet de justifier la pédérastie. Tel ethnologue citait
(positivement) le cas de cette tribu où le rite d’initiation incluait la
sodomie des jeunes initiés par le groupe des adultes. Exemple à suivre ?
Quelques leçons de notre histoire… si l’histoire peut donner des leçons
Il y a beaucoup de choses à dire de l’Ukraine. Beaucoup de choses déplaisantes, comme la corruption des classes dirigeantes, les usines à bé...
-
Ce dialogue (dont l’authenticité a été parfois contestée) passe pour être une véritable introduction à la philosophie de Platon. Il est sou...
-
Cher Rodolphe Cart, J’ai lu avec un intérêt soutenu votre livre consacré à Mélenchon, le bruit et la fureur. Portraits d’un révolutionnair...
-
1 Présentation générale 1.1 Platon : éléments biographiques et œuvres. I Les événements Platon serait...