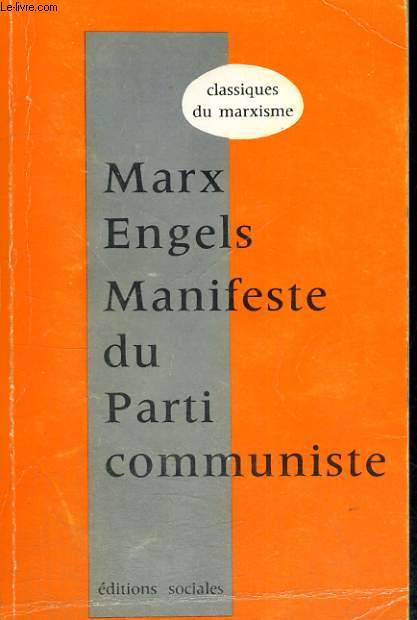Denis Collin analyse les menaces qui pèsent sur la liberté, incarnées par le libéralisme économique, le "politiquement correct" et l'islamisme. Selon lui, aussi curieux que cela puisse paraître, la gauche joue un rôle néfaste sur les trois plans. (Article publié le 12/11/2019 sur le site Marianne.net)
En 2011, j’avais publié un "essai sur la liberté au XXIe siècle" sous le titre La longueur de la chaîne (éditions Max Milo). Les années passées n’ont fait que confirmer les craintes qu’exprimait ce livre. Si Ronald Dworkin avait pu qualifier l’égalité de "valeur en voie de disparition" (cf. La vertu souveraine, Gallimard), je soutenais que la liberté, elle aussi, était en voie de disparition. Quant à la fraternité, inutile d’en parler, plus personne n’a la moindre idée de ce que cela pourrait vouloir dire.
Que la liberté suive l’égalité dans les "poubelles de l’histoire", c’est tout à fait compréhensible. La liberté n’a de sens que si elle est la liberté égale pour tous, sinon la liberté des uns a pour corollaire la servitude des autres. Les balivernes "libérales" qui opposent la liberté à une égalité qui serait une intolérable oppression ne font que reprendre, en inversant les signes, les balivernes staliniennes d’antan qui prétendaient qu’on devait sacrifier la liberté à l’égalité.
LA TRAHISON DE LA GAUCHE
L’égalité est un principe politique et moral qu’ont abandonné ceux qui étaient censés le défendre : les "partis de gauche" convertis au libéralisme économique et au "chacun pour sa pomme" depuis le "grand tournant" des années 80, depuis ces horribles années 80 qui ont vu les triomphes politiques, à la Pyrrhus, des Blair, Schröder et Mitterrand (un Mitterrand que l’exercice du pouvoir avait converti en un rien de temps à tout ce qu’il avait dénoncé avant son élection). Mais une fois que le renard est libéré dans le poulailler encore faut-il empêcher les poules de faire front contre le renard, d’appeler le fermier à leur secours ou de cribler de coups de becs cette horrible bête. C’est pourquoi, partout, à des degrés divers cependant, les pouvoirs répressifs des États se sont renforcés. Les dispositifs de surveillance, plus efficaces et plus raffinés que ceux imaginés par Orwell dans 1984, s’emparent de nos vies.
Des lois qui eussent horrifié les libéraux d’antan sont adoptées en rafale au motif de "lutte contre le terrorisme" (du Patriot Act américain à l’institutionnalisation française de l’état d’urgence). Même dans la patrie de la Magna Carta et de l’habeas corpus, Julien Assange est jeté dans un cul de basse fosse et jugé par une parodie de tribunal britannique aux ordres de son maître, l’État américain, celui d’Obama autant que celui de Trump. Dans la France "mère des droits de l’homme", les Gilets jaunes ont subi une répression impitoyable, éborgnant, blessant grièvement et jetant en prison des milliers de braves citoyens qui ne réclamaient qu’un peu de justice.
"C’est bien (...) un retour de l’ordre moral qui s’annonce, mais un ordre moral qui ne vient pas du côté où on l’attendait"
Mais on savait qu’on ne peut rien attendre des pouvoirs d’État tant qu’ils sont entre les mains des fondés de pouvoir de la classe dominante. La classe dominante domine, rien que très normal. Ce qui l’est moins, c’est l’apport venu de "l’extrême gauche" à cette entreprise de destruction de la liberté. La pulvérisation de la communauté politique consécutive au triomphe du néolibéralisme et de la marchandisation totalitaire a produit la naissance d’ "identités" nouvelles plus extravagantes les uns que les autres et de nouvelles "communautés" fantasmatiques qui prolifèrent comme les métastases du cancer capitaliste.
Chacun son identité, chacun sa volonté d’être reconnu et de faire taire tous ceux qui pourraient ne pas s’extasier devant les revendications folles de ces gens. Ainsi le "politiquement correct "qui a déjà ravagé les universités américaines et fourni les troupes réactionnaires (ou plutôt réactionnelles) qui ont fait Trump, a-t-il gagné la France. La censure la plus impitoyable commence à s’exercer dans le domaine de la culture – contre telle pièce de théâtre antique, contre tel auteur au programme de l’agrégation de lettres, contre telle philosophe accusée d’homophobie au motif qu’elle est opposée à la pratique des "mères porteuses". C’est bien comme le dit Pierre Jourde dans L’Obs un retour de l’ordre moral qui s’annonce, mais un ordre moral qui ne vient pas du côté où on l’attendait.
"La gauche de gauche, au nom d’un faux antiracisme s’est mise à la remorque de ceux qui pendent les communistes, battent les femmes et emprisonnent les syndicalistes"
En embuscade, le troisième parti des ennemis de la liberté a engagé le combat. Les islamistes (Frères Musulmans sous leurs divers faux nez, prédicateurs salafistes tous plus obscurantistes les uns que les autres, "antisionistes" enragés) ont engagé sous le drapeau de la "lutte contre l’islamophobie" une offensive de conquête politique visant à gagner l’hégémonie, d’abord sur les musulmans vivant en France à qui ils veulent imposer les coutumes et accoutrements des pays du Golfe. Cette hégémonie gagnée, ils pourront passer à la phase II, celle très bien décrite dans le roman de Houellebecq Soumission. Pour la phase I, ça marche comme sur des roulettes : la gauche de gauche, au nom d’un faux antiracisme s’est mise à la remorque de ceux qui pendent les communistes, battent les femmes et emprisonnent les syndicalistes dans les pays où ils ont le pouvoir.
"Espérons pourtant que la lutte de classe sera la plus forte, qu’elle balayera les miasmes de la décomposition de la gauche et que nous pourrons sortir de cette étreinte mortelle"
Telle est la situation désespérante dans laquelle nous sommes. Alors que l’offensive antisociale du gouvernement se poursuit à marche forcée et alors que les forces de résistances se manifestent, comme elles s’étaient manifestées l’an passé avec les Gilets jaunes, l’issue politique du mouvement social semble bouchée. Espérons pourtant que la lutte de classe sera la plus forte, qu’elle balayera les miasmes de la décomposition de la gauche et que nous pourrons sortir de cette étreinte mortelle.